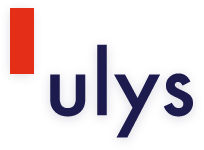Les professions libérales sur l’internet : des prestataires comme les autres ?
Publié le 23/12/2001 par
Thibault Verbiest, Etienne Wery
Le cadre juridique qui entoure l’accès et l’exercice d’une profession libérale est particulièrement touffu. Les titulaires de profession libérale exercent en effet souvent une mission qui tient à la fois du commerce (le but est bel et bien de réaliser un bénéfice) et de l’intérêt social (les avocats, médecins, comptables, ou architectes ne sont pas…
Le cadre juridique qui entoure l’accès et l’exercice d’une profession libérale est particulièrement touffu. Les titulaires de profession libérale exercent en effet souvent une mission qui tient à la fois du commerce (le but est bel et bien de réaliser un bénéfice) et de l’intérêt social (les avocats, médecins, comptables, ou architectes ne sont pas des commerçants ordinaires).
Cette particularité justifie la jungle de normes dans laquelle ils évoluent, et dont la provenance est multiple : les directives européennes bien entendu, mais aussi les textes nationaux, ainsi que les normes déontologiques ou les codes de bonne pratique professionnelle, etc.
L’exercice d’un cabinet libéral sur l’internet pose donc un double problème bien spécifique : ces normes permettent-elles la création d’un cabinet virtuel ? et si oui, quelle est la latitude d’action du prestataire ?
L’accès au cabinet virtuel
De très nombreuses professions libérales interdisent encore aujourd’hui à leurs membres d’exploiter un site web, fût-il une simple vitrine électronique du cabinet. Dans ces conditions, les professions autorisant un véritable site de commerce électronique (consultation en ligne par exemple) sont encore plus rares.
Cette situation devrait prochainement évoluer à la suite de l’adoption de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.
Conformément au principe de « non-autorisation préalable » énoncé à son article 4, les États membres doivent veiller à ce que l’accès à l’activité d’un prestataire de services de la société de l’information, et l’exercice de celle-ci, ne puissent pas être soumis à un régime d’autorisation préalable ou à toute autre exigence ayant un effet équivalent, sauf les régimes d’autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l’information.
La directive n’interdit donc pas les autorisations préalables, mais elle refuse les discriminations dont sont parfois victimes les acteurs électroniques par rapport aux prestataires qui opèrent en dehors de l’internet.
Pour les professions libérales comme pour les autres prestataires de la société de l’information, l’accès au cabinet virtuel n’est donc plus une faveur mais un droit. De nombreuses structures professionnelles (ordres, instituts professionnels, chambres professionnelles etc.) doivent dès à présent penser à réformer en ce sens leurs règlements.
Cela étant précisé, l’exercice de ce droit est strictement encadré comme nous allons le voir à présent.
Le marché unique
Autre caractéristique des professions libérales : elles sont souvent le parent pauvre de la liberté de circulation et de prestation au sein de l’Union européenne. De nombreuses professions de ce type sont en effet privées en tout ou en partie de ce droit fondamental. Il a par exemple fallu l’adoption d’une directive « avocats sans frontière » pour organiser les prestations et l’établissement en dehors du barreau d’origine.
Il est naïf de permettre aux professions libérales d’exploiter un cabinet virtuel si, au même moment, le marché potentiel est limité géographiquement au pays d’origine. En même temps, il est important de respecter les spécificités nationales qui peuvent avoir une répercussion sur la qualité du travail : le comptable italien mandaté par une société française pour réaliser et déposer des comptes annuels va-t-il le faire conformément aux normes françaises ou italiennes ?
La directive sur le commerce électronique a répondu à ce double souci en insérant une clause dite de marché intérieur, qui dispose que « Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné.
Les États membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre ». De cette formulation complexe, il faut retenir que :
-
Le contrôle des services de la société de l’information est réalisé par le pays d’origine, en accord avec son droit national, pour toutes les questions qui relèvent du domaine coordonné ;
-
Un Etat A ne peut restreindre les activités électroniques du prestataire d’un Etat B au nom d’une matière visée au domaine coordonné, même si ces activités sont dirigées vers le public de l’Etat A ;
-
La clause de marché intérieur convient tout particulièrement pour les professions libérales mais bénéficie à tous les prestataires d’un service de la société de l’information.
Il reste alors à définir le « domaine coordonné ». Ce terme vise toutes les exigences applicables à l’accès et à l’exercice des services de la société de l’information, qu’elles revêtent un caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement conçues pour eux. La volonté est clairement d’étendre la notion au maximum et, en quelque sorte, de forcer les Etats à harmoniser au plus vite leurs règlementations respectives.
Néanmoins, et ceci est capital, le domaine coordonné ne couvre pas les exigences applicables aux biens en tant que tels ou à leur livraison, ainsi qu’aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique.
Pour poursuivre l’exemple du comptable italien, ce dernier est donc soumis aux autorités italiennes qui appliquent le droit italien pour son activité, mais il doit respecter la réglementation applicable aux biens en tant que tels, c’est-à-dire, dans ce cas, le plan comptable et les règles de dépôt françaises.
L’affirmation doit toutefois être nuancée lorsque le service est presté intégralement par voie électronique, par exemple lors de l’accès à une base de données en ligne proposant des modèles de contrats qui sont livrés sous forme électronique.
Il n’est plus question ici de biens au sens de la directive (il s’agit d’un service) : l’ensemble de l’activité en ligne est alors régie par la loi du prestataire en vertu de la clause de marché intérieur.
La clause de marché intérieur, particulièrement favorable pour les prestataires électroniques, connaît des exceptions. Elle cède le pas aux lois nationales dans plusieurs domaines pour lesquels le législateur européen a estimé qu’un intérêt supérieur le justifiait. Relevons notamment (la liste exhaustive figure à l’article 3 et à l’annexe de la directive) : les droits de propriété intellectuelle ; la publicité afférente à la commercialisation des parts des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières ; plusieurs règles en matières d’assurance ; la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat ; les contrats conclus par les consommateurs ; le spamming.
Enfin, les États membres peuvent prendre des mesures qui dérogent à la clause de marché intérieur si le but poursuivi est la protection de l’ordre public, de la santé publique, de la sécurité publique ou la protection des consommateurs, pour autant que ces mesures visent spécifiquement le service qui représente un danger pour ces objectifs et que la mesure soit proportionnelle à ces objectifs. Ces mesures sont soigneusement contrôlées par la Commission européenne grâce à un système de notification.
La publicité et les services en ligne
Notre titulaire de profession libérale est à présent branché : il dispose d’un site web sur lequel il propose une vitrine de son cabinet traditionnel, et sur lequel il offre aussi de véritables activités professionnelles en ligne.
Le succès de son initiative passe inévitablement par de la publicité, lorsque le site web lui-même n’en constitue pas déjà une. Publicité ! Le mot est honni par presque tous les organismes professionnels chargés de contrôler l’activité des professions libérales. L’exemple des médecins est frappant : la simple distribution de cartes de visites à des patients potentiels est parfois réprimée durement par les Ordres. Que penser alors d’un site web ?
L’évolution est inévitable. S’agissant des professions réglementées, la directive prévoit que les communications commerciales qui font partie d’un service de la société de l’information doivent être autorisées, sous réserve toutefois du respect des règles professionnelles visant, notamment, l’indépendance, la dignité et l’honneur de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
Il ne suffit donc plus d’interdire « par habitude » ; il faut que l’interdiction soit justifiée, ce qui implique à tout le moins un débat au niveau de la profession. Pour le titulaire de profession libérale, plus que tout autre acteur de la société de l’information, l’internet est une révolution : il ne s’agit pas seulement d’un nouveau canal de vente mais d’une nouvelle manière de traiter avec la clientèle. La directive encourage la mise au point de codes de conduite au niveau européen, ce qui incitera probablement à un assouplissement des règles dans la mesure où les professions libérales anglo-saxonnes pratiquent la publicité de longue date.
A titre d’exemple, l’Ordre des avocats au barreau de Paris ainsi que l’Ordre français des avocats au barreau de Bruxelles ont pleinement pris conscience de ce qui précède en adoptant tous deux des prescriptions déontologiques ad hoc (pour le barreau de Paris : annexe au Règlement Intérieur adoptée par le Conseil de l’Ordre les 30 octobre 2000 et 6 novembre 2001 ; pour le barreau de Bruxelles : recommandation du 26 juin 2001).
Sans détailler l’intégralité de ces textes, notons que les services en ligne sont autorisés à condition que l’identification de l’avocat et de son interlocuteur soient assurés, et que la confidentialité soit respectée.
Si la demande qui lui est transmise lui paraît mal formulée, l’avocat qui fournit des prestations juridiques en ligne doit toujours être en mesure d’entrer personnellement et directement en relation avec l’internaute pour lui poser les questions nécessaires à l’élaboration d’une réponse appropriée ou lui faire les suggestions conduisant à la fourniture d’un service adapté à ses besoins.
Par ailleurs, l’avocat référencé par un site Internet de prestations juridiques peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site, à l’exclusion de toute rémunération proportionnelle aux honoraires perçus par l’avocat des clients avec qui le site l’a mis en relation. Cette hypothèse vise notamment les « places de marché », dont certaines proposent déjà des plate-formes de courtage de services juridiques.
La recommandation bruxelloise contient également une disposition relative aux forums de discussion : l’avocat peut participer à des forums de discussion s’il veille à ne fournir aucune consultation personnalisée qui pourrait mettre en péril le secret professionnel ou la nécessaire absence de conflit d’intérêts.
La directive européene sur le commerce électronique impose encore d’autres obligations. En effet, avant d’enregistrer une commande de son client, le prestataire devra fournir plusieurs informations minimales.
Parmi celles-ci figurent certaines exigences qui intéressent au premier chef les professions libérales : si l’activité est soumise à un régime d’autorisation le futur client doit recevoir les coordonnées de l’autorité de surveillance compétente ; en ce qui concerne les professions réglementées il doit connaître l’ordre professionnel ou l’organisme similaire auprès duquel le prestataire est établi, de même que le titre professionnel et l’État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que les règles professionnelles applicables ; il doit enfin être informé du moyen d’accéder à ces règles.
Enfin le client doit être informé du prix, ce qui n’est pas simple pour beaucoup de professions libérales où le calcul précis dépend de l’évolution du dossier ; en ce cas, le client doit au moins savoir comment le prix sera calculé (taux horaire, pourcentage, etc.).
Les noms de domaine « génériques »
Selon le réglement bruxellois précité, il est interdit à l’avocat de choisir un nom de domaine qui serait la reproduction d’un terme générique évocateur de la profession. Le but est d’éviter des abus visant à monopoliser des ressources uniques comme « avocat.com ».
Il est intéressant de relever à cet égard qu’un cabinet d’avocats toulousain a été condamné à cesser d’utiliser le nom de domaine « www.avocat-toulouse.com ». La question sous-jacente du litige était aussi simple que fondamentale : dans quelle mesure est-il possible de déposer un nom de domaine qui par sa signification elle-même a vocation à identifier une profession dans son ensemble ?
Selon le règlement intérieur du barreau de Toulouse, « l’avocat qui veut créer un site Internet doit le faire à son nom et au travers de sa structure professionnelle », ce qui a conduit le conseil de l’Ordre du barreau de Toulouse, en février 2001, à adresser au cabinet d’avocat une injonction de modifier son nom de domaine dans un délai de 15 jours. Le cabinet toulousain ne s’est pas soumis à l’injonction émise par l’Ordre, de sorte que le litige a été porté devant la du Cour d’Appel de Toulouse, qui a jugé qu’ « aucun auxiliaire de justice ne peut s’approprier, même indirectement, le terme générique de sa profession sur un site Internet et laisser ainsi entendre aux tiers non avertis, qu’il représente l’intégralité decette profession » .
L’utilisation de l’e-mail
Jusqu’il y a peu il était souvent difficile, voire impossible, d’établir la preuve d’un acte juridique créé exclusivement par voie électronique. La cause provenait du caractère formaliste du droit de la preuve.
Sans entrer dans les détails d’un régime probatoire à présent dépassé, retenons que le principe de base était la prééminence de la preuve littérale (l’écrit manuscrit) dès que l’objet de la transaction dépasse 5000 FF et que la personne contre qui on tente de faire la preuve n’est pas un commerçant. Or, l’écrit manuscrit signé requérait, grosso modo, une main se saisissant d’un stylo et apposant sur papier un graphisme correspondant à une signature. Il est difficile, dans ces conditions, de se fier à un e-mail.
Au-delà de cette question se profile le problème de l’identification. Un médecin recevant par e-mail une question de son patient au sujet d’une récente prise de sang n’a aucune certitude quant à l’identité de l’émetteur : est-ce bien son patient ou quelqu’un qui se fait passer pour lui ? Il pourrait être poursuivi pour violation du secret professionnel s’il a, même involontairement, transmis à un tiers cette information.
Pour répondre à ces problèmes le législateur européen a adopté une directive européenne sur les signatures électroniques, transposée depuis lors en France et en Belgique (voir notre rubrique « législation ») .
Le système actuel distingue deux signatures : l’une est dite « simple » et l’autre « avancée ». Les deux bénéficient de la clause de non-discrimination : le juge ne peut pas les écarter pour le seul motif qu’elles sont sous forme électronique. Mais la signature avancée bénéficie d’un grand avantage : moyennant le respect de certaines conditions, elle bénéficie d’une assimilation pure et simple à une signature manuscrite. Parmi les conditions, elle doit reposer sur un certificat qualifié.
C’est ici que les professions libérales ont un énorme rôle à jouer. Ce certificat est en effet délivré par un tiers (appelé prestataire de service de certification) qui atteste d’un certain nombre de choses, dont, en premier lieu, l’identité et la qualité du titulaire du certificat. Or, qui mieux qu’un institut professionnel ou un Ordre, peut attester que monsieur X est bel et bien celui qu’il prétend être et qu’il est effectivement autorisé à exercer la profession qui est la sienne ?
L’émission par les professions de ces certificats participe ainsi à prévenir les litiges en assurant une sécurité juridique totale dans la relation électronique avec les clients et les tiers (administrations, greffes, chambres et organismes divers…). Elle contribue en outre à créer une image moderne et rassurante de la profession. Enfin, elle permet une mutualisation du coût entre tous les membres de la profession.
L’Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles a conclu un accord dans ce sens avec Belgacom (du voir notre actualité ).
Cette convention constitue une première mondiale et suscite la curiosité des autorités ordinales de plusieurs pays. Elle permet à l’avocat de solliciter un certificat qui atteste son identité et sa qualité d’avocat, ainsi que les activités préférentielles pratiquées ou tout autre élément qui peut se révéler utile aux yeux des clients. L’avocat peut même, s’il le souhaite, devenir lui-même autorité locale d’enregistrement et émettre un certificat au profit de ses clients.
L’avocat a donc la possibilité d’entretenir avec son client une relation virtuelle qui garantit néanmoins l’authentification des parties, ainsi que la confidentialité et le maintien de l’intégrité des échanges.
Décidément, la profession libérale a bien changé.