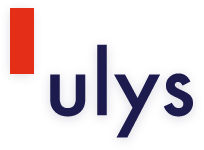Le point sur … la responsabilité de l’hébergeur
Publié le 02/02/2026 par
Etienne Wery
432 vues
Qui est encore un « hébergeur » au sens du droit européen ? À mesure que les plateformes organisent, classent et monétisent les contenus, la jurisprudence tend à restreindre leur statut d’intermédiaire neutre. Les décisions françaises récentes en donnent une illustration frappante, tandis qu’un nouvel arrêt attendu de la Cour de justice de l’Union européenne…
Qui est encore un « hébergeur » au sens du droit européen ? À mesure que les plateformes organisent, classent et monétisent les contenus, la jurisprudence tend à restreindre leur statut d’intermédiaire neutre. Les décisions françaises récentes en donnent une illustration frappante, tandis qu’un nouvel arrêt attendu de la Cour de justice de l’Union européenne pourrait rebattre les cartes. Cet article fait le point sur cette évolution et propose une lecture critique du débat : le droit continue de raisonner à partir du contenu individuel, alors que le pouvoir des plateformes s’exerce désormais sur l’architecture globale de visibilité des messages. Comprendre la responsabilité des intermédiaires suppose ainsi de changer d’échelle et de s’intéresser à ce « supra-contenu » qui structure l’espace informationnel en ligne.
Table des matières :
- Le texte de référence
- Pour être un hébergeur, il faut tout d’abord être … un service de la société de l’information
- Pour être un hébergeur, il faut ensuite être un intermédiaire neutre
- L’hébergeur n’a pas d’obligation générale de surveillance, mais il doit collaborer
- La Cour de cassation française est ultra-restrictive sur le critère de neutralité
- En pratique, qui est encore un hébergeur ? La jurisprudence française redéfinit-elle de facto la notion de l’hébergeur ?
- Aura-t-on bientôt une harmonisation du critère de neutralité grâce à l’arrêt ultime de la CJUE ?
- Et si l’on changeait d’échelle ? Une critique de l’avis de l’avocat général
Le texte de référence
Selon la directive sur le commerce électronique :
« 1. Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que :
a) le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente
ou
b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire.
3. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation et n’affecte pas non plus la possibilité, pour les États membres, d’instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l’accès impossible. »
Pour être un hébergeur, il faut tout d’abord être … un service de la société de l’information
La directive sur le commerce électronique s’applique aux services de la société de l’information et prévoit, pour trois d’entre eux, un régime de responsabilité allégée : le simple transport (art. 12), le stockage dit caching (art. 13) et l’hébergement (art. 14).
Le prestataire qui veut en bénéficier doit donc, en premier lieu, démontrer qu’il est un « service de la société de l’information », c’est-à-dire « tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique, à la demande individuelle d’un destinataire de services ».
Il y a donc quatre éléments qui caractérisent les services de la société de l’information :
- un service presté normalement contre rémunération ;
- à distance ;
- par voie électronique ;
- à la demande individuelle d’un destinataire de services.
Les choses sont relativement claires pour les sites qui proposent un service dématérialisé (par exemple un journal en ligne), ou un site de commerce électronique (par exemple une marque de vêtements, même si le bien acheté est ensuite livré physiquement).
La situation des services mixtes est plus subtile ; par « mixte », on vise les services composés d’un élément fourni par voie électronique et d’un autre qui n’est pas fourni par cette voie. Uber et Airbnb en sont de merveilleux exemples : vous commandez auprès d’un cuisinier que vous ne connaissez pas nécessairement et payez sur l’application, mais c’est (heureusement) une vraie pizza que vous mangez.
Arrêt Uber Spain (Asociación Profesional Elite Taxi).
Par son arrêt du 20 décembre 2017 (C-434/15), la CJUE a déclaré que le service d’intermédiation analysé doit être considéré comme étant indissociablement lié à un service de transport et comme relevant dès lors de la qualification de « service dans le domaine des transports » au sens du droit de l’Union. Un tel service doit par conséquent être exclu du champ d’application de la libre prestation des services en général ainsi que de la directive relative aux services dans le marché intérieur, ainsi que de la directive sur le commerce électronique car ce n’est pas un « service de la société de l’information ».
Pour arriver à ce résultat, la Cour considère tout d’abord que le service fourni par Uber ne se résume pas à un service d’intermédiation consistant à mettre en relation, au moyen d’une application pour téléphone intelligent, un chauffeur non professionnel (Uber Pop) utilisant son propre véhicule et une personne qui souhaite effectuer un déplacement urbain. En effet, dans cette situation, le fournisseur de ce service d’intermédiation crée en même temps une offre de services de transport urbain, qu’il rend accessible notamment par des outils informatiques et dont il organise le fonctionnement général en faveur des personnes désireuses de recourir à cette offre aux fins d’un déplacement urbain. La Cour relève à cet égard que l’application fournie par Uber est indispensable tant pour les chauffeurs que pour les personnes désireuses d’effectuer un déplacement urbain. Elle souligne également qu’Uber exerce aussi une influence décisive sur les conditions de la prestation des chauffeurs. Par conséquent, la Cour estime que ce service d’intermédiation doit être considéré comme faisant partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service de transport et, partant, comme répondant à la qualification non pas de « service de la société de l’information », mais de « service dans le domaine des transports ».
Arrêt Airbnb.
Un an plus tard, la CJUE arrivait à une conclusion opposée pour ce qui concerne Airbnb. En substance, la CJUE considérait que :
- Airbnb est dissociable de l’offre d’hébergement. A ce titre, la Cour a relevé, en premier lieu, que ce service ne tend pas uniquement à la réalisation immédiate de telles prestations, mais consiste pour l’essentiel en la fourniture d’un instrument de présentation et de recherche des logements mis à la location, facilitant la conclusion de futurs contrats de location. Dès lors, ce type de service ne saurait être considéré comme constituant le simple accessoire d’un service global d’hébergement.
- En deuxième lieu, la Cour a souligné qu’un service d’intermédiation tel que celui fourni par Airbnb Ireland n’est aucunement indispensable à la réalisation de prestations d’hébergement, les locataires et les loueurs disposant de nombreux autres canaux à cet effet, dont certains existent de longue date.
- En troisième lieu, enfin, la Cour a relevé qu’aucun élément du dossier n’indiquait qu’Airbnb fixerait ou plafonnerait le montant des loyers réclamés par les loueurs ayant recours à sa plateforme.
- La Cour a encore précisé que les autres prestations proposées par Airbnb Ireland ne permettent pas de remettre en cause ce constat, ces diverses prestations étant simplement accessoires au service d’intermédiation fourni par cette société. En outre, elle a indiqué que, à la différence des services d’intermédiation en cause dans les arrêts Asociación Profesional Elite Taxi et Uber France, ni ce service d’intermédiation ni les prestations accessoires proposés par Airbnb Ireland ne permettent d’établir l’existence d’une influence décisive exercée par cette société sur les services d’hébergement auxquels se rapporte son activité, s’agissant tant de la détermination des prix des loyers réclamés que de la sélection des loueurs ou des logements mis en location sur sa plateforme.
En grande chambre, la CJUE décidait donc qu’un service d’intermédiation qui a pour objet, au moyen d’une plate-forme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d’hébergement de courte durée, tout en fournissant également un certain nombre de prestations accessoires à ce service d’intermédiation, doit être qualifié de « service de la société de l’information » relevant de la directive 2000/31 sur le commerce électronique.
Arrêt Star Taxi App.
Ensuite, la Cour a rendu un arrêt relatif au copycat roumain de Uber : Star Taxi App, société établie à Bucarest, qui exploite une application qui met en relation directe les utilisateurs de services de taxi avec les chauffeurs de taxi. Cette application permet d’effectuer une recherche faisant apparaître une liste de chauffeurs de taxi disponibles pour effectuer une course. Le client est alors libre de choisir un chauffeur sur cette liste. Cette société ne transmet pas les réservations aux chauffeurs de taxi ni fixe le prix de la course qui est payée directement au chauffeur à la fin de celle-ci. Ces caractéristiques ont permis à la CJUE de s’éloigner de l’arrêt Uber Spain et de voir, dans le système proposé par Star Taxi, un service de la société de l’information
Pour être un hébergeur, il faut ensuite être un intermédiaire neutre
Dans Google France, se référant au considérant 42, la CJUE a jugé que les dérogations ne couvrent que l’activité du prestataire qui revêt un caractère « purement technique, automatique et passif », impliquant que ledit prestataire « n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées » (§ 113), ce qu’elle décrit aussi comme un comportement « neutre, en ce que son comportement est purement technique, automatique et passif, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle des données qu’il stocke. » (§ 114).
Elle a répété sa position dans L’Oréal au sujet des places de marché (eBay en l’occurrence), jugeant que :
- pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un «prestataire intermédiaire» au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive (voir arrêt Google France et Google, précité, point 112).
- Il n’en va pas ainsi lorsque le prestataire du service, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de celui-ci au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données (arrêt Google France et Google, précité, points 114 et 120).
- Le simple fait que l’exploitant d’une place de marché en ligne stocke sur son serveur les offres à la vente, fixe les modalités de son service, est rémunéré pour celui-ci et donne des renseignements d’ordre général à ses clients ne saurait avoir pour effet de le priver des dérogations en matière de responsabilité. Lorsque, en revanche, il a prêté une assistance, consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir ces offres, il y a lieu de considérer qu’il a non pas occupé une position neutre entre le client vendeur concerné et les acheteurs potentiels, mais joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres. Il ne saurait alors se prévaloir, s’agissant desdites données, de la dérogation en matière de responsabilité visée à l’article 14 de la directive 2000/31.
C’est la même logique qui a permis à la CJUE, dans Papasavvas, d’exclure de la notion d’hébergeur, la société éditrice de presse à l’égard de son site Web « dès lors qu’elle a connaissance des informations publiées et exerce un contrôle sur celles-ci ».
L’hébergeur n’a pas d’obligation générale de surveillance, mais il doit collaborer
Les intermédiaires (caching, hébergeur, fournisseur d’accès) ne peuvent pas se voir imposer une « obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ».
Mais, ils doivent parfois collaborer : la directive permet en effet aux Etats de mettre à leur charge « l’obligation d’informer promptement les autorités publiques compétentes d’activités illicites alléguées qu’exerceraient les destinataires de leurs services ou d’informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d’identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d’hébergement ».
L’arrêt Glawischnig-Piesczek est le seul rendu par la CJUE sur ce sujet. En substance, la question consistait à déterminer la portée d’une injonction adressée à un hébergeur sur pied de l’article 15, sur :
- le plan matériel : l’injonction se limite-t-elle au message illicite, ou peut-elle être étendue aux contenus identiques, ou encore peut-elle aller jusqu’à viser les contenus équivalents ?
- le plan personnel : l’injonction peut-elle viser d’autres personnes que l’auteur du message d’origine ?
- le plan territorial : l’injonction peut-elle être ordonnée au nouveau mondial ?
La Cour commence par trancher la question de l’obligation « générale » de surveillance : renvoyant au considérant 47 de la directive, elle souligne qu’une telle interdiction ne concerne pas les obligations de surveillance « applicables à un cas spécifique » (point 34), ce qui peut être le cas d’une information précise, stockée par l’hébergeur concerné à la demande d’un certain utilisateur de son réseau social, dont le contenu a été analysé et apprécié par une juridiction compétente de l’État membre qui, à l’issue de son appréciation, l’a déclarée illicite (point 35).
Vu la nature des réseaux sociaux et les outils de partage et de rediffusion qui les caractérisent, la Cour estime qu’il est légitime que la juridiction nationale puisse étendre l’injonction aux informations dont le contenu est identique à celui déclaré illicite, quel que soit l’émetteur. Il en découle une sorte de droit de suite sur le contenu jugé illicite qui a été partagé ou repris par des tiers : la suppression du premier entraîne la suppression du deuxième, et ainsi de suite pour tout contenu identique repris ou partagé.
Le plus innovant est toutefois à venir. En effet, la Cour avait été saisie d’une question spécifique sur les informations de contenu équivalent, c’est-à-dire « des informations véhiculant un message dont le contenu reste, en substance, inchangé et, dès lors, diverge très peu de celui ayant donné lieu au constat d’illicéité » (point 39). La Cour n’imagine pas qu’il soit possible d’assurer la finalité de l’injonction (faire cesser un acte illicite et en prévenir la réitération ainsi que toute nouvelle atteinte aux intérêts concernés), si ses effets étaient limités aux contenus identiques. Elle suggère de s’attacher au contenu du message plutôt qu’aux mots ou leur combinaison, sous peine de conduire la personne concernée à devoir multiplier les procédures aux fins d’obtenir la cessation des agissements dont elle est victime (point 41). Il n’a pas échappé à la Cour que la mise en œuvre de son arrêt n’ira pas sans susciter de nombreuses difficultés. Pour elle, la réponse est dans la qualité de la rédaction de l’injonction : il importe, dit-elle, que « les informations équivalentes (…) comportent des éléments spécifiques dûment identifiés par l’auteur de l’injonction, tels que le nom de la personne concernée par la violation constatée précédemment, les circonstances dans lesquelles cette violation a été constatée ainsi qu’un contenu équivalent à celui qui a été déclaré illicite ». On comprend à la lecture de l’arrêt que la frontière est franchie dès l’instant où « l’hébergeur concerné [doit] procéder à une appréciation autonome dudit contenu » (point 45).
La Cour de cassation française est ultra-restrictive sur le critère de neutralité
S’appuyant sur les arrêts Google France, L’oréal et Papasavvas de la CJUE (voir supra), la Cour de cassation française se montre ultra-restrictive sur le critère de neutralité.
Dans son arrêt Ticketbis, elle était saisie d’une action intentée par la Fédération Française de Football (FFF) contre la société Ticketbis SL, société de droit espagnol, qui exploite une site par lequel elle met en relation des revendeurs et des acheteurs potentiels de billets donnant accès à des événements sportifs ou culturels, notamment des billets de matches de football de l’Equipe de France se déroulant en France. La FFF reproche à la société Ticketbis de contrevenir aux dispositions de l’article 313-6-2 du code pénal et de l’article 4.4 des conditions générales d’acquisition et d’utilisation des billets pour les matches organisés par la FFF en France intitulé « restrictions d’utilisation ».
Appliquant le critère de neutralité au cas d’espèce, elle retient que :
- le site offrait aux éventuels acquéreurs de billets la possibilité de faire des choix entre les différentes compétitions sportives programmées,
- un commentaire sportif sur les matches à venir illustrait celles-ci, tel « dernière ligne droite avant la prochaine Coupe du Monde » ou « La France favorite face au Luxembourg »,
- ces commentaires se concluent par la phrase « tous les matchs de qualification du Mondial 2018 sont à suivre en direct grâce à Ticketbis qui vous permet non seulement d’acheter mais de vendre vos billets de match de foot »,
- la société Ticketbis sécurisait la transaction.
Voir notre commentaire précédent sur cet arrêt.
La Cour de cassation vient de répéter son message dans deux récents arrêts Airbnb (arrêt 1 et arrêt 2).
En substance, Airbnb se retranchait derrière son statut d’hébergeur pour refuser d’assumer les conséquences financières d’une arnaque survenue via son site (fausses annonces). La cour d’appel lui avait donné raison, mais la cour de cassation casse l’arrêt, estimant que Airbnb ne joue pas un rôle neutre à l’égard de ses utilisateurs : elle s’immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs » :
- en leur imposant de suivre un ensemble de règles (lors de la publication de l’annonce ou de la transaction) dont elle est en mesure de vérifier le respect ;
- en promouvant certaines offres par l’attribution de la qualité de « superhost », exerçant ainsi une influence sur le comportement des utilisateurs.
Pour la cour de cassation, Airbnb a donc un rôle actif, lui permettant d’avoir connaissance et de contrôler les offres déposées sur sa plateforme, incompatible avec la qualité d’hébergeur internet telle que la définit la loi de 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Dès lors, la société ne bénéficie pas de l’exonération de responsabilité que cette loi accorde aux hébergeurs et peut donc voir sa responsabilité engagée lorsque les utilisateurs recourent à sa plateforme pour de la sous-location illicite.
En pratique, qui est encore un hébergeur ? La jurisprudence française redéfinit-elle de facto la notion de l’hébergeur ?
En pratique, la figure de l’hébergeur en droit français tend à se resserrer autour des acteurs d’infrastructure : si les prestataires qui se bornent à assurer un stockage technique (fournisseurs d’hébergement, services de cloud ou d’infrastructure réseau) correspondent au modèle du prestataire « purement technique, automatique et passif »., en revanche, dès qu’un service organise l’information qu’il héberge ou structure la rencontre entre utilisateurs, sa qualification devient incertaine.
Les répercussions sont légion :
- Les plateformes de petites annonces. Un modèle minimaliste, proche d’un simple tableau d’affichage numérique, demeure certes compatible avec l’exigence de neutralité, mais dans la mesure où la viabilité économique des services gratuits repose généralement sur des mécanismes de monétisation indirecte (mise en avant payante, classement différencié, badges de confiance, promotion algorithmique) qui impliquent une hiérarchisation commerciale des contenus, il n’y a plus de stockage passif. La plateforme cesse alors d’être un simple intermédiaire technique pour devenir un organisateur de visibilité, ce qui fragilise sa revendication au statut d’hébergeur.
- Les réseaux sociaux. Leur valeur ajoutée ne réside pas dans la conservation des contenus mais dans leur circulation : recommandation algorithmique, hiérarchisation des flux, modération, ciblage publicitaire. Le cœur du service est l’optimisation de l’attention (garder le visiteur devant son écran à tout prix), et non le stockage. Appliqué à la française, le critère de neutralité n’est plus satisfait. La jurisprudence récente illustre cette évolution : Meta a été condamnée à la suite de la diffusion de publicités frauduleuses usurpant la marque du Groupe Barrière et, fait remarquable, la cour d’appel a appliqué à la lettre la jurisprudence Glawischnig-Piesczek : « la mesure de filtrage ordonnée, mise en oeuvre à l’aide du système automatisé de Meta d’identification et de désactivation des publications non conformes à ses standards, est limitée dans son objet, à savoir la promotion de jeux d’argent et de hasard en ligne contenant les marques Barrière, dans sa durée, réduite par le juge de la rétractation à une période de douze mois, et dans sa portée territoriale limitée à l’Union européenne de sorte qu’elle n’est ni disproportionnée ni inéquitable. La cour ajoute qu’il est constant que la société Meta a mis en oeuvre la mesure ordonnée laquelle s’est avérée effective pour réduire très fortement les contenus illicites litigieux, et qu’elle ne démontre pas que cette mesure est inadaptée aux ressources et aux capacités dont elle dispose, que son exécution lui a occasionné un sacrifice insupportable ou qu’elle s’est avérée incompatible avec ses autres obligations » (arrêt disponible ci-dessous).
- Les moteurs de recherche. À l’origine, le moteur était conçu comme un outil d’indexation technique. Il recensait automatiquement des pages accessibles publiquement et facilitait leur repérage, sans intervenir dans leur contenu ni dans les transactions auxquelles elles pouvaient donner lieu. Sa fonction était celle d’un guide dans un espace informationnel préexistant. Ceci a conduit la CJUE a se montrer plutôt compréhensive avec Google dans son arrêt de 2010. Depuis lors, l’évolution du service est patente : le classement algorithmique, la personnalisation des résultats, l’intégration de contenus sponsorisés, l’intégration d’outils d’IA qui ont pour but de dispenser le visiteur de visiter les autres sites, l’affichage enrichi ou encore les liens avec les autres services du groupe (géolocalisation, shopping, publicité, etc.) ont changé le rôle du moteur qui, non content de signaler des contenus, organise l’accès à l’information et influence directement leur exposition économique, en privilégiant ses propres intérêts.
Aura-t-on bientôt une harmonisation plus précise grâce à un nouvel arrêt ultime de la CJUE ?
Ce passionnant débat devrait connaitre bientôt un nouvel épisode.
Une affaire est en effet pendante devant la CJUE, dans laquelle l’avocat général suggère une nouvelle lecture. Fait notable, c’est le premier avocat lui-même, M. Szpunar, qui est aux manettes et qui met tout son poids dans la balance.
L’affaire concerne les fonctionnalités YPP de Google (YouTube Partner Program) : la signature d’un accord de partenariat commercial uniquement avec certains utilisateurs ; l’examen d’un échantillon de vidéos mises en ligne par les créateurs de contenu ; les fonctionnalités supplémentaires de la plateforme uniquement disponibles pour les partenaires vérifiés ; et le partage des recettes.
L’avocat général commence par rappeler que la responsabilité allégée de l’hébergeur implique un test en deux étapes :
- Premièrement, le prestataire de services doit fournir un service de la société de l’information qui consiste en un « hébergement » au sens de l’article 14 de cette directive ; en outre, son comportement doit se limiter à celui d’un « prestataire intermédiaire » .
- Deuxièmement, le prestataire de services ne doit pas avoir effectivement connaissance de l’activité illicite ou, dès le moment où il en a connaissance, il agit promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.
C’est au stade de la première étape que l’on s’interroge sur la question de la neutralité et de la passivité.
L’avocat général est tranché : « (…) je partage l’avis de l’avocat général Jääskinen [dans L’Oréal] selon lequel, la « neutralité », prise isolément, peut ne pas être le critère le plus approprié pour déterminer si un prestataire de services d’hébergement relève de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31. En effet, on peut se demander si les prestataires de services d’hébergement pourraient jamais être considérés comme entièrement « neutres ». En principe, un prestataire de services d’hébergement qui tire des recettes publicitaires de sa plateforme est intéressé par une augmentation du nombre d’utilisateurs et de vues.
De même, la dichotomie du rôle passif ou actif semble insuffisante pour tenir compte des activités exercées par un tel prestataire, en particulier dans un domaine en constante évolution. En tout état de cause, il me semble que, conformément à la jurisprudence, tant la neutralité que la passivité impliquent un modèle commercial qui repose a priori sur une absence de « connaissance ou de contrôle du contenu ».
En substance, la neutralité et la passivité devraient être comprises par référence au contenu que les créateurs mettent en ligne sur une plateforme. »
Le système qu’il propose revient à considérer que le prestataire n’est pas un hébergeur neutre :
- s’il participe à la rédaction, à la création et à la sélection de contenus ;
- s’il contrôle ou examine les contenus avant leur téléversement, ou
- s’il les optimise.
En revanche, l’hébergeur reste protégé par le régime allégé de responsabilité même :
- s’il est rémunéré pour ces services ;
- s’il met en œuvre des mesures techniques pour détecter les contenus illicites ; ou
- s’il propose certaines fonctions d’affichage sur sa plateforme.
Ayant déplacé l’analyse de neutralité et de passivité autour du contenu et précisé sa pensée, l’avocat général propose de scinder les choses :
- l’« optimisation technique ou d’affichage », qui ne suffit pas à considérer que l’hébergeur a perdu sa neutralité ; et
- l’« optimisation du contenu » qui, elle, rend inapplicable le régime allégé de responsabilité à défaut de neutralité.
Il considère que les techniques de monétisation proposées par Youtube « améliorent l’expérience des utilisateurs et tendent donc à augmenter le nombre de clics, ce qui est inhérent au modèle commercial de toute plateforme de partage de vidéos. Si cela reste dans les limites de l’optimisation de l’affichage, alors l’activité continue d’être celle d’un intermédiaire. L’augmentation du nombre de clics ne devient problématique que si, pour ce faire, la plateforme influence le contenu lui-même. »
Il reste, et l’avocat général le reconnaît, que le modèle qu’il propose déplace la question sans réellement la résoudre : on s’interrogera désormais sur la nature de « l’optimisation » (est-elle technique ou d’affichage, ou vise-t-elle au contraire le contenu) pour apprécier la neutralité.
L’avocat général suggère enfin de ne pas donner à ce débat une importance démesurée. Depuis l’arrêt Glawischnig-Piesczek, la cour a adopté une lecture souple et extensive du devoir de collaboration et des injonctions qu’il est possible d’adresser à un hébergeur. Il ne faut donc pas craindre une zone de non-droit : il s’agit essentiellement de conserver intacte la volonté du législateur, qui souhaitait soutenir l’innovation et assurer la pluralité des opinions en évitant de faire peser sur les hébergeurs une responsabilité qui les amènerait inévitablement à exercer une forme de censure.
Et si l’on changeait d’échelle ? Une critique de l’avis de l’avocat général
Le raisonnement de l’avocat général repose sur une hypothèse implicite : l’unité pertinente d’analyse est le contenu pris isolément. Une vidéo. Une annonce. Un post. Pour l’avocat général, tant que ce contenu individuel n’est pas « sélectionné » par le prestataire, et qu’il ne participe ni à sa rédaction ni à sa création, celui-ci reste un hébergeur au sens de la directive, même s’il optimise l’affichage.
Or l’économie actuelle des plateformes ne repose plus principalement sur le stockage de contenus individuels. Elle repose sur l’organisation de leur circulation. La valeur n’est pas créée par la conservation des messages, mais par la manière dont ils sont classés, recommandés et rendus visibles. On est entré, pour les plateformes, dans une économie de l’attention : le but est de capter l’attention du visiteur et la conserver aussi longtemps que possible, grâce à des contenus formatés et personnalisés, afin de monétiser davantage l’audience. Dans ce modèle, le contenu individuel compte moins que le flux dans lequel il s’inscrit.
Il faut donc distinguer deux niveaux.
Le premier est celui du contenu individuel : le message concret publié par un utilisateur.
Le second est ce que l’on peut appeler le supra-contenu : l’architecture qui organise la relation entre les contenus. Le supra-contenu correspond aux systèmes de recommandation, aux classements algorithmiques, aux mécanismes de mise en avant et de personnalisation. Ce n’est pas un message supplémentaire ; c’est la structure du flux qui crée la valeur, qui détermine ce que les utilisateurs voient, dans quel ordre, et avec quelle intensité.
Sous cet angle, la proposition de l’avocat général apparaît comme une occasion manquée. En se concentrant sur le contenu individuel, elle laisse de côté le lieu réel d’exercice du pouvoir des plateformes : la maîtrise du supra-contenu. Une plateforme peut ne jamais modifier matériellement un message particulier tout en contrôlant de façon décisive l’environnement dans lequel ce message apparaît, s’insère et façonne la perception du visiteur. La neutralité appréciée à l’échelle d’un contenu isolé ne garantit donc aucune neutralité à l’échelle du système.
Plus encore, le supra-contenu n’est pas un simple décor. Il influence la production des messages eux-mêmes. Les créateurs adaptent leurs contenus aux règles de visibilité : formats favorisés, durées optimales, logiques de recommandation, incitations économiques. Les créateurs adaptent aussi leur contenu aux possibilités de ciblage, comme l’a montré l’affaire Cambridge Analytica (contenus créés spécifiquement pour des destinataires déterminés en vue d’influencer une élection). Autre exemple : les formats musicaux, qui changent pour s’adapter aux plateformes, par exemple dans la structure de la chanson. Progressivement, l’architecture du flux façonne la nature des contenus hébergés. La plateforme qui contrôle la circulation des messages existants oriente indirectement les messages futurs, et influe donc sur leur création et leur rédaction.
Cette observation fragilise également la distinction proposée par l’avocat général sur son propre terrain. Celui-ci admet qu’un prestataire qui participe à la sélection du contenu ne peut plus être regardé comme un hébergeur neutre au sens de la directive. Mais l’insertion algorithmique d’un message dans un supra-contenu n’est-elle pas déjà une forme de sélection et, bien plus directement qu’on ne le croit, une influence sur sa création ?
Classer un contenu, le recommander ou le reléguer n’est pas une opération neutre. C’est décider de sa place relative dans l’espace informationnel et, dans ce qui est désormais devenu une économie de l’attention, c’est influer sur l’existence même des contenus individuels et leur portée réelle.
Le régime de responsabilité des hébergeurs a été construit pour un internet centré sur le stockage. Il suppose des objets informationnels stables, déposés sur un serveur. L’économie de l’attention a bouleversé ceci. Tant que l’analyse juridique reste focalisée sur le contenu individuel, elle manque le niveau systémique où s’exerce désormais l’essentiel du pouvoir informationnel. Le débat sur la responsabilité des hébergeurs ne porte plus vraiment sur la modification des contenus, mais sur la maîtrise de l’architecture informationnelle dans laquelle ces contenus existent.