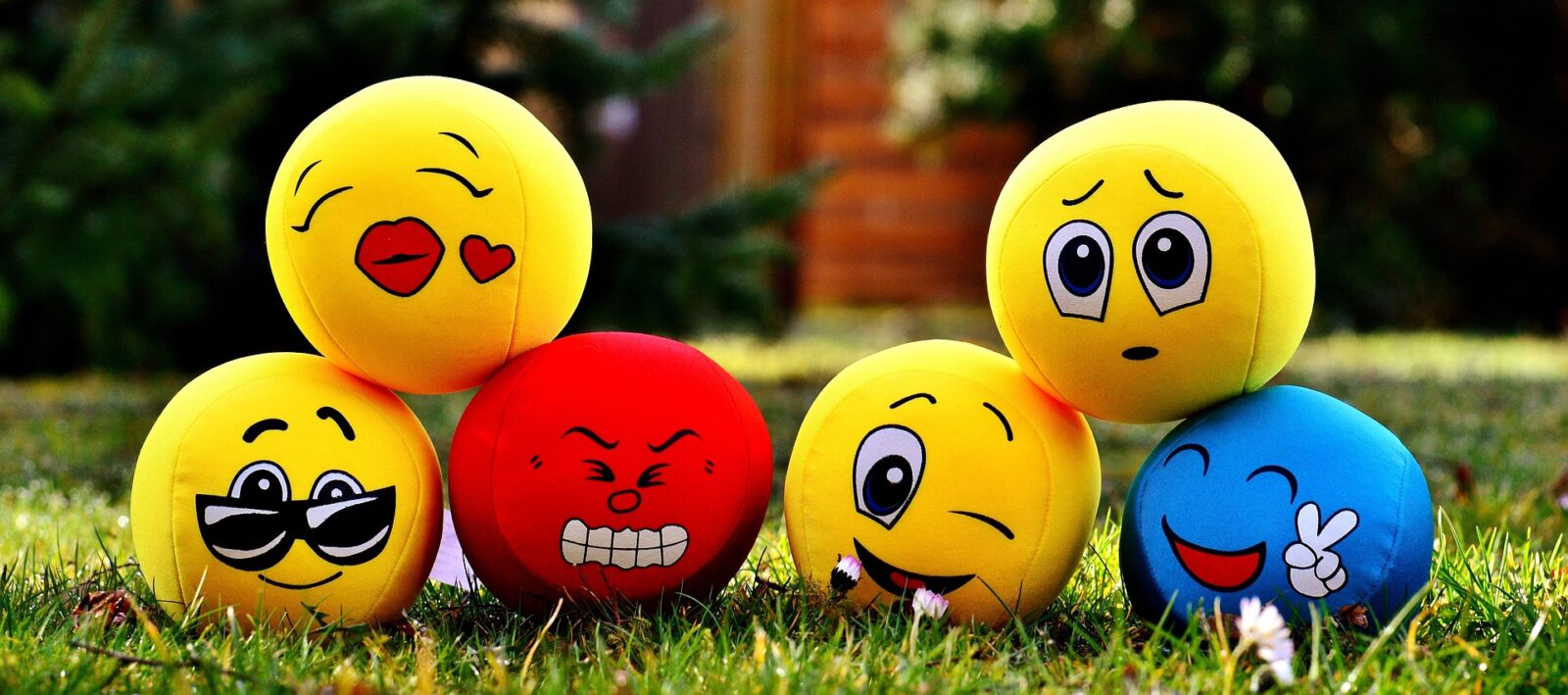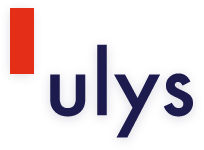Un émoji « pouce levé » peut-il constituer une signature contractuelle ?
Publié le 28/07/2025 par
Etienne Wery
705 vues
Un emoji peut-il valoir engagement contractuel ? C’est à cette question qu’ont répondu les juridictions canadiennes, saisies d’un litige entre un agriculteur et une société sur fond de messagerie texte. À partir d’un simple pouce levé envoyé en réaction à une photo de contrat, les juges de la Cour suprême canadienne ont reconnu la formation…
Un emoji peut-il valoir engagement contractuel ? C’est à cette question qu’ont répondu les juridictions canadiennes, saisies d’un litige entre un agriculteur et une société sur fond de messagerie texte. À partir d’un simple pouce levé envoyé en réaction à une photo de contrat, les juges de la Cour suprême canadienne ont reconnu la formation d’un accord et la validité d’une signature électronique. L’affaire, au-delà de son apparence anecdotique, interroge profondément les standards modernes de preuve et de consentement à l’ère numérique.
À la lumière du règlement eIDAS et des principes européens, une solution similaire aurait toutes les chances de s’imposer en droit de l’Union.
Les faits
Un agriculteur et une société avaient parlé de conclure un contrat en vertu duquel le premier livrerait du lin à la seconde à une date postérieure.
L’acheteur a envoyé une photographie de la première page du contrat par messagerie texte à l’agriculteur, avec les mots « veuillez confirmer le contrat relatif au lin ».
L’agriculteur a répondu par l’émoji du pouce en l’air.
Plus tard, il revient sur sa décision, prétextant n’être pas tenu de livrer le lin à la société, qui réclame des dommages-intérêts pour violation du contrat.
Les décisions rendues
Devant la Cour du Banc du Roi, le juge siégeant en cabinet a rendu un jugement sommaire en faveur de la société, considérant que :
- Les parties avaient depuis longtemps une relation commerciale par laquelle la demanderesse vendait du grain à l’intimée.
- Depuis 2020, les parties concluaient de tels contrats par messagerie texte, que le mandataire de la demanderesse approuvait en envoyant de brefs messages tels que « ouais », « d’accord » ou « c’est beau ».
- La procédure suivie dans le cas en l’espèce était presque identique, et dans les circonstances en question, l’émoji du pouce en l’air constituait une signature représentant l’intention de la demanderesse d’être liée par le contrat.
La Cour d’appel a conclu à l’unanimité que les parties étaient parvenues à un accord de volonté et qu’il y avait certitude quant aux conditions du contrat.
Toutefois, elle était partagée sur la question de savoir si l’émoji constituait une signature au sens du par. 6(1) de la loi intitulée The Sale of Goods Act (Saskatchewan). Les juges majoritaires ont conclu que le juge siégeant en cabinet n’a pas fait erreur en concluant que l’émoji constituait une signature dans les circonstances de l’espèce, et la Cour d’appel a rejeté l’appel.
La Cour suprême a décidé de clôturer la procédure d’appel, confirmant ainsi la décision : l’agriculteur est tenu par un contrat valablement signé, sa signature se manifestant par l’emoji « pouce levé ».
Et en Europe ?
Il nous semble que la solution serait probablement la même.
eIDAS (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) est un règlement européen qui a pour objectif principal est de favoriser la confiance dans les transactions électroniques au sein de l’UE, en harmonisant les normes et en garantissant la reconnaissance mutuelle des méthodes d’identification et des signatures électroniques entre les États membres.
Le règlement eIDAS crée 3 catégories de signatures électroniques :
Signature « Simple »
Des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer.
→ Bénéficie du principe de non-discrimination.
Signature « Avancée »
Conditions d’une signature simple ET : a) être liée au signataire de manière univoque ; b) permettre d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
→ Bénéficie du principe de non-discrimination.
Signature « Qualifiée »
Conditions d’une signature avancée ET : a) être créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique (c’est-à-dire un dispositif logiciel ou matériel configuré servant à créer une signature électronique) ; b) être qualifiée (c’est-à-dire satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe II) ; c) reposer sur un certificat qualifié de signature électronique (c’est-à-dire satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe II).
→ Bénéficie du principe de non-discrimination et du principe d’assimilation.
On comprend d’emblée que la logique suivie part d’un système relativement léger (un code PIN constitue une signature « simple ») pour aller vers un système de plus en plus lourd sur le plan des contraintes de sécurité.
Logiquement, il s’ensuit que le règlement attache aux divers mécanismes, des effets juridiques qui vont croissants.
C’est l’article 25 du règlement qui s’attache aux effets juridiques des divers mécanismes de signatures électroniques, et pose deux principes essentiels :
- Principe de non-discrimination : « L’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée ».
- Principe d’assimilation : « L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite. »
Le principe de non-discrimination est extrêmement puissant, car il interdit de rejeter la preuve présentée pour le seul motif qu’elle est sous forme électronique, y compris dans une relation à distance.
La Cour de justice a récemment confirmé la puissance de ce principe, jugeant au sujet d’un avis de redressement fiscal que « [le règlement eIDAS] n’interdit pas aux juridictions nationales d’invalider les signatures électroniques, mais établit un principe général interdisant auxdites juridictions de refuser l’effet juridique et la force probante des signatures électroniques dans des procédures en justice au seul motif que ces signatures se présentent sous une forme électronique ou qu’elles ne satisfont pas aux exigences établies par le règlement no 910/2014 pour qu’une signature électronique puisse être considérée comme une signature électronique qualifiée » (C-362/21, 20 octobre 2022).
Dans le même sens, le nouveau Code civil belge précise à l’article 8.1 les notions de « signature » et de « signature électronique » :
- Signature : « un signe ou une suite de signes tracés à la main, par voie électronique ou par un autre procédé, par lesquels une personne s’identifie et manifeste sa volonté » ;
- Signature électronique : « une signature conforme aux articles 3,10° à 3,12° du Règlement [eIDAS] ».
Si l’on applique cela aux faits décrits ci-dessus, il est probable qu’un juge européen aboutirait à la même conclusion :
- Il commencerait par refuser de disqualifier purement et simplement l’emoji, parce qu’agir autrement serait une violation du principe de non-discrimination ;
- Il refuserait de voir dans l’emoji une signature électronique qualifiée car les conditions ne sont pas remplies ;
- Il regarderait ensuite, dans le contexte qui lui est présenté, si l’Emoji peut être raisonnablement considéré comme 1) identifiant l’agriculteur (la réponse positive étant probable si c’est le même numéro qui est utilisé depuis longtemps dans le cadre de relations suivies entre les parties) ; et 2) si l’emoji manifeste la volonté de l’agriculteur (ce qui est également probable vu la relation suivie entre l’agriculteur et l’acheteur et la brièveté des messages antérieurs qui n’avaient pas posé de souci).