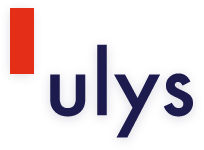Les contentieux liés aux contrats informatiques
Publié le 18/04/2017 par
Etienne Wery , Hervé Jacquemin
- 0 vues
1 Introduction
Lorsqu’une entreprise fait appel à un prestataire IT pour s’informatiser, qu’il s’agisse d’acquérir du matériel (hardware), des logiciels (software), et/ou bénéficier de prestations accessoires (maintenance ou formation du personnel, par exemple), il n’est malheureusement pas rare que des difficultés surviennent.
Les problèmes peuvent se manifester très tôt, par exemple au cours de négociations rompues abusivement par l’une des parties, ou plus tardivement, en cours d’exécution du contrat, lorsqu’il apparaît que la solution logicielle proposée n’est pas compatible avec les autres applications du clients.
Ils peuvent trouver leur origine dans des manquements du client et/ou du prestataire IT.
Dans le chef du client, le prestataire pointera généralement le non-paiement du prix ou le manque de réactivité dans la vérification et l’acceptation des livrables.
Quant au prestataire, on lui reprochera par exemple un manque d’information du client relativement aux limites du système proposé ou aux risques – notamment financiers – encourus, l’exécution tardive de ses obligations, une mauvaise exécution du contrat (avec une solution IT qui ne correspond pas aux attentes, par exemple) voire encore la perte de données lors de l’installation d’un nouveau logiciel.
En général, les parties tenteront d’abord de trouver un terrain d’entente, de manière à résoudre le litige à l’amiable. Dans certains cas, ces discussions se révéleront malheureusement infructueuses et une phase contentieuse s’ouvrira devant les juridictions compétentes.
A cet égards, trois remarques s’imposent :
- Si le litige présente un élément d’extranéité (parce que le prestataire est établi en France et le client en Belgique, par exemple), il faudra préalablement déterminer quelle est la juridiction compétente et la loi applicable. Normalement, ce point est précisé dans le contrat (dans les dispositions finales). Lors de la rédaction du contrat, il faut encourager chaque partie à veiller, en fonction de la marge de négociation dont elle dispose, à désigner les juridictions de son for et sa loi nationale (pour limiter les frais occasionnés par une procédure à l’étranger et se prémunir des incertitudes liées à l’application d’un droit étranger, auquel on n’est pas familiarisé).
- Au plus tard au début de la phase contentieuse, chaque partie devra « constituer son dossier », en rassemblant les éléments de preuve de nature à soutenir sa position, en tant que demandeur ou défendeur (convention telle que signée, cahier des charges, mise en demeure éventuelle, PV d’acceptation des livrables, documents échangés lors des négociations, etc.). Avoir un bon ou, au contraire, un mauvais dossier, conditionnera généralement l’issue du procès. Aussi faut-il conseiller aux parties, in tempore non suspecto de se ménager toutes les preuves possibles des engagements pris par les uns et les autres, de manière à les produire rapidement et facilement en cas de litige. Sur ce point, on sera attentif au fait que, dans la plupart des contrats IT, une clause spécifique est introduite en vue de limiter le cadre contractuel à la convention telle que signée, de manière à exclure les documents échangés lors de la période précontractuelle (PV de réunion, emails échangés, lettre d’intention, etc.). Une telle clause est par exemple formulée comme suit : « l’accord contenu dans la Convention comprend l’entier accord des Parties et annule, écarte et remplace toute communication antérieure, écrite ou orale, confidentielle ou officielle, entre les Parties ou leurs conseils respectifs tant au sujet de la Convention qu’en ce qui concerne ses annexes, sauf mention expresse de ces documents dans la Convention ». En cas de litige, les documents sur lesquels on pourra utilement se fonder seront donc potentiellement moins nombreux.
- L’objet même du contrat étant relativement complexe, sur le plan technique (puisqu’il porte sur du matériel IT, des logiciels standards ou sur mesure, ou de la maintenance, par exemple), il n’est pas rare que le juge désigne un expert pour l’éclairer, par exemple en établissant si les travaux de développement et d’analyse réalisés par le prestataire sont conformes aux règles de l’art et/ou pour évaluer le préjudice subi par les parties.
On examine successivement le contentieux lié à la phase précontractuelle (jusque, et y compris, la conclusion du contrat en tant que telle), et le contentieux contemporain à l’exécution du contrat.
On part du postulat que le contentieux s’inscrit dans une relation contractuelle B2B nouée entre un client « professionnel » et un prestataire (forcément professionnel). Lorsque le client est un « consommateur », des dispositions légales ou réglementaires additionnelles sont susceptibles de s’appliquer, pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs (interdiction des clauses abusives ou des pratiques commerciales déloyales, obligations d’information, exigences de forme, droit de rétractation, etc.). Ces règles ne sont toutefois pas étudiées ici.
L’analyse est présentée en droit français et en droit belge. La matière est principalement régie par la théorie générale des obligations et des contrats, conformément aux dispositions du Code civil, interprétées par la doctrine et la jurisprudence. S’agissant de dispositions similaires, l’interprétation était généralement convergente (étant entendu que, dans certains cas, des différences doivent cependant être constatées). Aussi la doctrine et les juridictions belges ont-elles pu s’inspirer, utilement des analyses françaises.
Pour le droit français, il faut toutefois noter une évolution importante, depuis l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations[1]. On veillera à indiquer les nouvelles dispositions du Code civil français, potentiellement applicables au contentieux des contrats de l’informatique, tout en les mettant en perspective, à la lumière de la jurisprudence rendue en la matière.
2 le contentieux lié à la phase précontractuelle
2.1 La rupture des négociations
Dans le domaine des contrats informatiques, les négociations menant à la conclusion du contrat peuvent être plus ou moins longues.
La durée des discussions dépendra en général de la complexité des opérations d’informatisation envisagées (informatisation sur la base de produits standards ou moyennant la création de produits sur mesure, etc.), ainsi que des enjeux financiers sous-jacents.
Lorsque la phase précontractuelle s’inscrit dans la durée, il n’est pas rare que les parties rythment les négociations par l’établissement de divers documents, qui permettent de fixer par écrit les éléments sur lesquels elles sont parvenues à s’entendre. Outre un accord de confidentialité (Non-Disclosure Agreement), les parties veilleront aussi à s’échanger les PV des réunions ou à établir une lettre d’intention, voire un Memorandum of Understandings (MoU). Ces documents constatent généralement la volonté des parties de collaborer et fixent les éléments sur lesquels elles ne souhaitent plus rouvrir de discussions ultérieures (le périmètre de la mission, le choix d’une technologie, certains accords en termes de prix, etc.).
Il faut souligner que, nonobstant l’existence de ces documents, les parties restent libres de conclure ou de ne pas conclure le contrat (par application du principe de la liberté contractuelle). En France, cet élément résulte désormais de l’article 1112 du Code civil (tel qu’introduit par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), aux termes duquel « « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ». Auparavant, en l’absence de disposition spécifique dans le Code civil (comme c’est toujours le cas en Belgique, d’ailleurs), il fallait se référer à jurisprudence. D’après celle-ci, la rupture des négociations peut ainsi se révéler fautive, si elle intervient à contretemps (la veille de la signature du contrat, après des mois de négociations) ou s’il est démontré que l’une des parties n’avait jamais eu la moindre intention de conclure le contrat, les négociations ayant uniquement été lancées en vue d’obtenir une offre compétitive pour discuter en parallèle et en secret avec un autre partenaire.
Le nouvel article 1112, alinéa 2, du Code civil français ajoute qu’ « en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu », ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation française[2]. Dans un arrêt du 7 janvier 2009 (rendu toutefois dans une matière étrangère aux contrats IT), la 3e chambre civile a ainsi décidé que « la faute commise dans l’exercice du droit de rupture des unilatérale des pourparlers précontractuels ne peut être la cause d’un préjudice dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat »[3].
En toute état de cause, pour engager la responsabilité d’une partie suite à une rupture abusive des négociations, on se placera normalement sur le plan de la responsabilité extracontractuelle, ce qui exige de démontrer une faute en lien de causalité avec un dommage. La réunion des conditions propres à chacun de ces éléments devra faire l’objet d’une analyse en fait, à la lumière du cas d’espèce soumis au juge.
2.2 L’obligation d’information au cours de la phase précontractuelle
2.2.1 Contours de l’obligation d’information
D’un point de vue statique, la validité d’une convention requiert, outre la capacité des parties, un objet certain ainsi que le consentement de celui qui s’oblige[4]. Ce consentement doit être libre et éclairé.
Aussi la doctrine et la jurisprudence ont-elles dégagé diverses obligations d’information (à charge de l’une des parties ou des deux parties) visant précisément à permettre à chaque cocontractant de consentir en pleine connaissance de cause. Elles trouvent leur source dans l’exigence de bonne foi[5], qui s’impose à toutes les étapes du processus contractuel.
En France, un nouvel article 1112-1 a été introduit dans le Code civil : il prévoit que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ».
Sur ce point, la matière des contrats informatiques s’est révélée un terreau fertile[6], en termes de contentieux, et les cours et tribunaux ont été appelés à préciser les contours de cette obligation d’information, tout en veillant à sanctionner sa méconnaissance de manière adéquate.
A ce stade, seule l’obligation d’information ayant pour objet de protéger le consentement retient notre attention (pour l’obligation d’information requise en cours d’exécution du contrat, voy. infra).
De manière générale, le fournisseur doit ainsi informer le client sur les éléments caractéristiques du matériel fourni ou du logiciel installé. Il doit le conseiller ou le mettre en garde, à la lumière de ses attentes ou besoins concrets[7]. Cette obligation d’information lui impose également de se renseigner[8]. Dans un arrêt du 16 octobre 2015, la Cour d’appel de Paris a ainsi jugé que « la société Le Saint Alexis soutient à juste titre que la société Apicius était débitrice envers elle d’un devoir de conseil. A cet égard, il appartenait non seulement à celle-ci d’informer la société Le Saint Alexis des limites de sa prestation et donc des restrictions concernant les fonctionnalités du logiciel Console My Room mais également de se renseigner sur les besoins de son client et de l’aider à exprimer ses besoins afin de l’orienter au mieux dans ses choix et de lui faire connaître, le cas échéant, la nécessité de souscrire un contrat auprès d’un tiers pour obtenir ladite fonctionnalité »[9].
Parallèlement, le client a l’obligation de collaborer de bonne foi à la définition du projet, en communiquant au prestataire les informations demandées.
Un dialogue doit s’installer entre les parties, de sorte qu’au terme de l’analyse, la solution la plus adéquate pour le client soit trouvée. Il n’en reste pas moins que ce dialogue doit être dirigé par le professionnel de l’informatique[10] : il a ainsi été jugé que « ce manque de dialogue implique évidemment les deux parties, étant cependant entendu que le professionnel […] par ses connaissances spécialisées et son expérience, est mieux préparé pour analyser de façon approfondie les besoins réels de sa cliente, pour mettre en garde celle-ci sur la faisabilité de certaines opérations, pour l’éclairer sur les limites, difficultés ou conditions d’exécution optimale de sa fourniture et de son installation du logiciel »[11].
L’intensité de l’obligation d’information peut varier suivant plusieurs facteurs.
Elle est ainsi plus importante dans l’hypothèse d’un logiciel sur mesure (par comparaison à un progiciel ou logiciel standard). Une juridiction belge a ainsi relevé que, dans la mesure où il ne s’agissait pas en l’espèce d’un logiciel sur mesure, le fournisseur n’était pas tenu d’analyser l’entreprise de l’acheteur[12]. Parallèlement, si l’obligation d’information du fournisseur demeurait, il incombait également au client d’informer celui-ci sur les caractéristiques de sa gestion d’entreprise, auxquelles le logiciel devait répondre.
De même, on attend davantage d’information du prestataire lorsqu’il vend ses produits à une PME de quelques personnes, qui n’ont pas de compétence particulière dans l’informatique (ou dans les aspects légaux des contrats IT, ou, au contraire, lorsque le client est une institution bancaire forte d’un service juridique et d’un service IT de plusieurs (dizaines de) personnes hautement qualifiées. Dans un arrêt du 11 juillet 2006, la Cour de cassation française a ainsi décidé que « pour condamner la société Téléfil santé à payer à la société CDA la somme de 5 976 euros et, en conséquence, la débouter de sa demande d’indemnisation, l’arrêt retient que la société Téléfil santé n’avait pas informé la société CDA que la police de caractère « Roman » n’existait pas sur son imprimante ; […] en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel d’un matériel informatique est tenu d’une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de toute compétence en la matière, la cour d’appel a violé les textes susvisés »[13]. Ce dernier fait devra évidemment faire l’objet d’une analyse au cas par cas, en fonction des éléments de fait du dossier.
Dans une affaire soumise à la Cour d’appel de Paris, celle-ci a considéré que le client n’était pas un « profane de l’informatique ». Elle juge en effet qu’ « il n’est pas démontré que ITS a manqué à son devoir de renseignement et à son obligation de conseil s’agissant du matériel, des logiciels et plus généralement de la solution Si4 retenue ; qu’au surplus, si ITS est un professionnel de l’informatique, AA ne peut prétendre être totalement profane dès lors qu’elle utilisait auparavant la solution Sigip dont le paramétrage a été repris, en étant limité à la nouvelle dimension de AA devenue société indépendante et en étant adapté à la solution Si4 étant en outre observé que AA employait deux personnes chargées de l’informatique, dont un technicien et administrateur réseau/Informatique et Réseau ; qu’il n’est pas davantage établi que ITS a manqué à son obligation de moyens relativement à la formation dispensée au personnel de AA pour l’utilisation et l’exploitation du logiciel Si4 »[14].
2.2.2 Sanctions du non-respect de l’obligation d’information
La sanction du non-respect de l’obligation d’information est désormais visée à l’article 1112-1 du Code civil français, qui rappelle les principes relatifs à la charge de la preuve, tout en mentionnant les sanctions : « il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Il s’agit des sanctions qui étaient auparavant préconisées par la doctrine, et appliquées par la jurisprudence (et qui le restent, en droit belge, en l’absence de disposition légale spécifique). Nous examinons successivement la responsabilité extracontractuelle et les vices du consentement.
2.2.2.1 Responsabilité extracontractuelle
Le non-respect de l’obligation d’information visant à protéger le consentement des parties peut être sanctionné sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle[15]. Une faute, en lien de causalité avec un dommage, doit ainsi être démontrée. On parle dans cette hypothèse de culpa in contrahendo.
Pour apprécier l’existence d’une faute, on comparera le comportement du prestataire à celui d’un prestataire normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances concrètes de fait. Normalement, l’obligation d’information au stade précontractuel est une obligation de moyen ; aussi incombe-t-il au client d’apporter la preuve du manquement.
Un lien de causalité doit exister entre le faute et le dommage (à apprécier à l’aune de la théorie de l’équivalence des conditions, qui exige de retenir toutes les causes fautives sans lesquelles le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit in concreto).
Dans l’hypothèse d’un manquement à l’obligation d’information, le prestataire pourrait prétendre que le lien de causalité n’est pas certain : autrement dit, il est possible que, sans la faute, le dommage ne se serait produit de la même manière, tout comme on peut défendre l’idée que sans la faute, le dommage aurait quand même eu lieu (parce que, par exemple, le client n’en aurait pas tenu compte ou n’aurait pas compris l’information transmise). En l’absence de lien causal certain, le juge devra conclure à l’absence de responsabilité dans le chef du prestataire, sauf si l’autre partie a invoqué la théorie de la perte d’une chance. Dans cette hypothèse, il faut rechercher un lien de causalité entre le dommage et la perte d’une chance d’éviter la survenance d’un risque. Pour une illustration dans le domaine des contrats IT, voyez infra).
Pour se défendre d’un manquement éventuel à son obligation d’information, le prestataire pourrait aussi invoquer une faute du client qui n’aurait pas effectué les démarches nécessaires en vue de se renseigner, ou pour transmettre au professionnel les informations lui permettant de le conseiller adéquatement. Il y aurait dans ce cas une faute de la victime, constituant une cause étrangère exonératoire de responsabilité, et susceptible de donner lieu à un partage de responsabilité (concrètement, la victime devra assumer une partie du préjudice).
Si les conditions de la responsabilité civile extracontractuelle sont réunies, le client pourra généralement recevoir des dommages-intérêts.
2.2.2.2 Vice du consentement
Le client pourrait également arguer que son consentement a été vicié, à la suite d’une erreur ou en raison d’un dol dont il a été victime de la part du prestataire.
Les nouvelles dispositions du Code civil français[16], consacrées à l’erreur et au dol codifient, sauf exception, les principes tirés de la jurisprudence antérieure, tout en clarifiant le texte normatif. En droit belge, c’est à la jurisprudence qu’il importe de se référer[17].
Le contrat peut être annulé si l’erreur porte sur les qualités essentielles de la prestation ou de la personne du cocontractant. L’erreur doit également être commune à toutes les parties[18] (2) et excusable (3). Ces conditions sont analysées avec attention par la jurisprudence.
Un système informatique est généralement constitué de plusieurs logiciels et leur interopérabilité peut, dans certains cas, poser problème. La jurisprudence a ainsi été amenée à trancher des différends dans lesquels le client se plaignait de difficultés de cette nature et demandait l’annulation de la convention, pour erreur sur la substance. La juridiction saisie a ainsi relevé que « l’erreur porte sur l’interopérabilité en mode compatible du logiciel, qui apparaît comme ‘un élément qui a déterminé principalement la partie à agir ou à contracter en telle sorte que, sans cet élément, le contrat n’eût pas été conclu’ » et ajoute que « cette erreur était de celles que, dans des circonstances semblables, tout autre commerçant normalement prudent et diligent aurait pu commettre (…) » (caractère excusable de l’erreur). Cet arrêt d’appel est toutefois cassé par la Cour de cassation belge, le caractère commun de l’erreur faisant défaut en l’espèce[19]. Comme le souligne la Cour, « loin de constater que [l]es qualités substantielles étaient connues du cocontractant, l’arrêt [d’appel] considère que la défenderesse n’établit ni « avoir signalé [à la demanderesse], durant la phase précontractuelle, que [ces éléments] figuraient parmi ses besoins » ni « qu’il serait de la nature de ce logiciel […] d’offrir un service d’ ‘interopérabilité’ en mode compatible » ». En conséquence, la décision d’annulation n’était pas fondée.
On retient aussi un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 28 octobre 2009, rendu dans un litige entre un client et son fournisseur d’accès à internet. La Cour considère que le client, la « société Global Internet Solutions Network, qui se qualifie d’acteur majeur du commerce électronique en Europe et déclare être spécialisée dans le traitement sécurisé des flux bancaires et sensibles, est à l’évidence un spécialiste de l’internet ; […] à ce titre, elle ne pouvait ignorer les capacités techniques de la liaison de secours RNIS, laquelle, selon ses écritures, a été mis en œuvre à partir de novembre 2004, soit quelques mois avant la signature du nouveau contrat ; […] ayant pris l’initiative de faire doubler son débit d’accès à internet, elle se devait, en sa qualité de professionnel, de faire le choix d’une ligne de secours corrélativement ajustée »[20]. Aussi la Cour conclut-elle que « c’est donc par suite d’une erreur inexcusable de sa part qu’elle a, lors de la signature de l’avenant en février 2005, décidé de maintenir le lien de secours à 128 Kbits/s ».
Le dol exige quant à lui des « manœuvres » ou des mensonges émanant d’une partie et ayant pour but de tromper le cocontractant, sous l’effet de l’erreur créée dans son esprit. Les « manœuvres » exigent un élément matériel (des mensonges ou des omissions, que l’on qualifie de « réticences dolosives ») et un élément intentionnel (une volonté de tromper). Ces manœuvres doivent être déterminantes pour le consentement. A la différence de l’erreur, on ne tient pas compte d’une faute éventuelle de la victime, eu égard au principe fraus omnia corrumpit : comme l’énonce le nouvel article 1139 du Code civil français, « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ».
Dans un litige entre la Maif et IBM, où la Cour d’appel de Bordeaux est appelée à se prononcer après que la Cour de cassation[21] ait cassé l’arrêt rendu le 25 novembre 2011 par la Cour d’appel de Poitiers, la Maif reprochait à IBM d’avoir commis un dol. Par arrêt du 29 janvier 2015, la Cour d’appel de Bordeaux rappelle que « la Maif soutient que la société IBM France s’est rendue coupable de dol par réticence dans des conditions qui l’ont conduite à tromper sa cocontractante en lui dissimulant des informations qui, si elle les avait connues, l’auraient déterminée à ne pas contracter. Elle fait valoir qu’elle a été trompée par IBM au moment de la signature du contrat d’intégration (14 décembre 2004), puis dans chacun des protocoles des 30 septembre 2005 et 22 décembre 2005 »[22]. Le moyen du dol est toutefois rejeté par la Cour, qui décide notamment que « la Maif ne peut prétendre avoir été trompée, lors de la signature du protocole du 30 septembre 2005, sur les enjeux techniques du projet ni leur possible évolution. Les manœuvres frauduleuses n’étant pas établies, le dol invoqué par la Maif ne saurait être retenu. En toute hypothèse là encore, à supposer ces manœuvres constituées, il n’est pas
établi qu’IBM ait eu l’intention de tromper sa cocontractante, pas plus qu’il n’est démontré que la Maif ne se serait pas engagée par le biais du protocole litigieux si elle avait connu la teneur du scénario que devait proposer IBM le 14 novembre 2005, une contre-lettre du même jour signée entre les parties lui ayant ouvert la possibilité de se prévaloir de la caducité du protocole ».
L’erreur et le dol peuvent donner lieu à l’annulation du contrat conclu par les parties[23]. Il s’agit d’une nullité relative, instaurée au bénéfice de la victime du dol ou de l’erreur. L’annulation exige normalement le retour au statu quo ante, avec des restitutions réciproques dans le chef des parties.
Le cas échéant, des dommages et intérêts complémentaires peuvent être alloués pour réparer le dommage.
2.3 La formation du contrat par la rencontre entre une offre et une acceptation
D’un point de vue dynamique, une convention se forme lorsque l’offre émise par l’une des parties est acceptée par le cocontractant potentiel.
En France, l’offre et l’acceptation font désormais l’objet de dispositions spécifiques dans le Code civil, aux articles 1113 et suivants[24] (ce qui n’était pas le cas auparavant, et ce qui reste le cas en Belgique, où cette question fait l’objet de développements jurisprudentiels).
Dans l’affaire jugée en 2007[25] par une juridiction belge, une entreprise informatique adresse diverses offres à son client, suivies de factures et, après paiement d’un acompte, lui fournit les logiciels visés (les bons de livraison sont par ailleurs signés par le client). Le client prétend néanmoins qu’aucun contrat n’a été conclu (les parties seraient restées au stade des négociations) et refuse de payer les factures en souffrance. Après avoir souligné le silence et l’absence de réponse du client à son interlocuteur pendant plusieurs mois, le Tribunal décide qu’ « un contractant ne peut soutenir, sans faire preuve d’une mauvaise foi manifeste, que le paiement sans remarque d’un acompte de 20%, correspondant à l’offre qui lui a été faite, ne constitue pas l’acceptation de cette offre »[26]. S’agissant des offres complémentaires, les bons de livraison ont été signés sans remarque ni contestation.
L’acceptation est un acte juridique unilatéral, qui doit être prouvé conformément aux règles applicables, en droit civil ou commercial.
Il a ainsi été jugé ce qui suit par la Cour d’appel de Paris : « considérant que Madame B. ne peut non plus valablement soutenir la nullité du bon de commande au motif, retenu à tort par le Tribunal, d’une prétendue incertitude concernant les prestations fournies par la société C. ; qu’en effet, la lecture du bon de commande permet de constater une description précise du matériel livré (unité centrale PC, écran 15’, clavier, souris, modem, haut-parleur avec installation et mise en service du site internet créé, outre quatre heures de formation du personnel utilisateur ; que les prestations concernant le suivi du site créé sont tout aussi détaillés ainsi que le contrat de participation commerciale, signé le même jour ; qu’ainsi Mme B. s’est engagée sur des éléments précis, après avoir remplir dûment un questionnaire prouvant ses connaissances tant en informatique que des sites internet, étant surabondamment observé qu’elle est la signataire du questionnaire de renseignements et qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été rempli à son insu par une tierce personne »[27]. Il apparaît donc que l’offre était suffisamment précise et que la commande faite par le client valait acceptation.
3 Le contentieux lié à l’exécution
3.1 Les droits et les obligations des parties au stade de l’exécution du contrat
3.1.1 La délivrance
3.1.1.1 Régime général
En ce qui concerne l’exécution du contrat, le vendeur (au sens large, cela comprend les prestataires de services) à une obligation principale : délivrer.
La délivrance est un fait juridique, défini par la doctrine comme « la mise à disposition de la chose à l’acquéreur, au temps et au lieu convenus »[28]. Le Code civil y voit « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur » (art. 1604).
Il y a trois éléments caractéristiques qui ressortent de cette définition :
- L’obligation de délivrer « la chose ». Il s’agit de s’assurer que la chose délivrée est bien celle qui est l’enjeu du contrat : « la délivrance oblige le vendeur de la chose à remettre à son vis-à-vis une chose conforme en tous points aux spécifications contractuelles »[29].
- La délivrance doit avoir lieu « au temps » convenu. Il s’agit de s’assurer du respect du calendrier.
- La délivrance doit se faire « au lieu » convenu. La délivrance ne se confond pas avec la livraison, qui est en rapport avec le transport de la chose vendue lorsqu’un tel transport est nécessaire.
Les deux premiers éléments nécessitent quelques développements.
3.1.1.2 L’obligation de délivrer la chose convenue
La conformité de la chose est l’objet d’un important contentieux. L’exemple typique – et caricatural – est la commande d’une voiture avec boîte automatique là où la livraison porte sur une voiture munie d’une boîte manuelle. En pratique, les choses sont plus subtiles.
En principe, il n’est pas nécessaire d’établir que la divergence cause un préjudice. Le fait que l’objet délivré ne soit pas conforme au contrat, suffit à caractériser le manquement à l’obligation de délivrance conforme. En pratique, il arrive que certains juges vérifient l’existence d’un préjudice, surtout lorsque le manquement allégué résulte d’une considération subjective et non d’une spécification objective du contrat (par exemple, si la voiture ne dépasse le 130 km à l’heure, les juges auront tendance à traiter différemment le dossier selon que la documentation contractuelle prévoit expressément une vitesse maximale différente – auquel cas le manquement est aussitôt établi – ou non).
On enseigne traditionnellement que la chose délivrée doit être (1) de même nature, (2) de même qualité et (3) de même quantité que la chose convenue. Dans les faits, il n’est pas toujours simple de classifier le manquement en fonction de la nature, la qualité ou la quantité (exemple : un temps de réponse dégradé porte-t-il sur la nature du logiciel ou sa qualité ?). Il en s’agit toutefois pas d’un problème, car la délivrance conforme nécessite la réunion des trois conditions. Qu’il en manque une, peu importe laquelle, et l’obligation n’est pas remplie.
L’acquéreur peut en principe refuser de prendre livraison et demander réparation du préjudice subi dès lors qu’il peut faire état d’une différence, aussi minime soit-elle, entre la chose livrée et celle prévue dans l’accord de volontés[30]. On affirme parfois qu’il faut une correspondance parfaite entre la chose matériellement remise et la chose préalablement et abstraitement décrite dans le contrat. En pratique, les juges ne sont pas toujours aussi stricts, surtout s’ils ont le sentiment d’être instrumentalisés par un client qui monte en épingle un problème véniel dans le but de se débarrasser d’une solution pour des raisons propres étrangères à cette solution.
Il y a deux cas de figures principaux :
- Les spécificités explicites : le contrat stipule les caractéristiques de la chose.
Le contrat peut contenir, dans le corps du texte, en annexe ou par référence, des spécificités explicitement attendues. On parle des « spécifications » ou du « référentiel de conformité ». Lorsque pareilles spécifications existent, c’est évidemment à l’aune de celles-ci que le juge vérifiera au premier chef si l’objet livré est conforme. Il s’agit d’un cas typique dans lequel la démonstration d’un préjudice n’est en principe pas requise.
La sévérité est habituellement de mise. Le manquement peut par exemple être établi du simple fait que le système n’atteint pas les performances minimales annoncées[31].
- Les spécificités implicites.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation et ils en font largement usage, si nécessaire après avoir sollicité l’avis d’un expert judiciaire.
On se réfère souvent à l’état de l’art et/ou aux usages commerciaux. La notion est extrêmement importante. On vise sous cette appellation toutes les spécifications qui ne sont pas dites parce que – dans l’esprit d’une partie au moins – elles coulent de source eu égard au secteur, à la nature de la chose vendue, à son utilisation présumée, etc.
Exemple : une entreprise de tourisme commande un nouveau logiciel de réservation et vente de billets d’avion. À l’usage, il apparaît que le logiciel n’est pas capable de gérer les fuseaux horaires, ce qui est problématique pour de nombreux vols. Cela n’a pas été précisé dans le cahier des charges. Le client va invoquer l’état de l’art et/ou les usages : à ses yeux, il est évident qu’un logiciel de ce type doit pouvoir gérer les fuseaux horaires même si ce n’est pas explicitement dit.
La destination normale du bien fait partie des éléments régulièrement pris en compte.
Il y a souvent dans le raisonnement une forme de présomption d’utilité : si une chose a été achetée, c’est pour répondre à une situation jugée insatisfaisante ; le produit est supposé intervenir, seul ou en combinaison avec d’autres éléments, pour rétablir la satisfaction. Si le produit se révèle inutile dans cette perspective alors que sa destination normale aurait permis de combler le besoin, on est souvent confronté à un manquement à l’obligation de délivrance.
Les documents précontractuels jouent un rôle central à cet égard. Le cas typique et l’appel d’offres ou le cahier des charges qui reprend la liste des caractéristiques attendues du bien. La question n’est pas tellement de savoir si le document précontractuel fait partie ou non du contrat ; l’enjeu est surtout d’apprécier la délivrance conforme : un cahier des charges qui énonce des spécificités attendues oblige le vendeur à se positionner. S’il s’engage en sachant que l’objet vendu n’est pas en mesure de satisfaire le besoin exprimé ou les spécificités énoncées, il s’expose à un manquement à l’obligation de délivrance conforme. En outre, la jurisprudence a développé à la charge du vendeur spécialiste une obligation d’information, parfois très poussée, au point d’en faire une partie intégrante de la délivrance elle-même (cf. infra, sur ce point).
Le prix est un autre élément, quoique souvent moins décisif. Contrairement aux qualités intrinsèques de la chose (absence de coup d’un bien acheté neuf) qui sont couramment utilisées comme référence, le prix peut en effet résulter du contexte et/ou de l’habilité à la négociation.
La jurisprudence traduit cette exigence en matière commerciale en énonçant que le vendeur est tenu, lorsque le contrat de vente ne spécifie aucune qualité particulière, de délivrer une marchandise « loyale et marchande », c’est-à-dire une chose de qualité correcte au regard de sa destination normale.
En matière informatique, on relèvera la différence de traitement que l’on observe régulièrement entre les transactions dites simples (par exemple la licence octroyée sur un progiciel) ou complexes (par exemple la licence sur un progiciel de gestion qui nécessite un long paramétrage et une intégration périlleuse).
Dans le premier cas, le fournisseur bien avisé aura limité son obligation de conformité à la documentation précise du progiciel. Le plus souvent, le juge validera le raisonnement car le contrat est la loi des parties. Lorsque le contrat est muet, le fournisseur s’expose à se voir opposer un arrêt de la Cour de cassation de 2008 selon lequel « tout concepteur d’un progiciel a l’obligation de s’assurer que ce progiciel, au moment de sa cession, réponde tant aux besoins du client qu’aux obligations légales prévues ou prévisibles pour sa durée de vie, durée de l’amortissement, durée d’utilisation effective »[32].
Les choses sont plus subtiles dans le second cas. Les développements qui précèdent au sujet des spécifications et de la compétence du client, retrouvent toute leur importance. Le contexte est quant à lui posé par un arrêt de 2006 de la Cour de cassation selon lequel « l’obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue »[33]. Elle casse ainsi l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Limoge, qui avait retenu que « le logiciel vendu avait été mal initialisé pour l’application spécifique de la société Téléfil santé, les fichiers de la base de données de l’ancien logiciel n’ayant pas été transmis par celle-ci à la société CDA qui n’avait pas pu les reporter sur le nouveau système ».
Enfin, on signalera qu’il faut non seulement livrer la chose convenue, mais aussi les accessoires habituels comme l’exige l’article 1615 du Code civil : « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ». On peut imaginer par exemple que l’absence d’un manuel utilisateur puisse être sanctionnée sur cette base. La question de la remise des codes source est souvent traitée sur cette base, avec un bonheur inégal.
3.1.1.3 L’obligation de délivrer au temps convenu
Très souvent – par exemple dans les ventes de consommation au détail – la délivrance est synchrone avec la commande et le paiement. Tel est par exemple le cas d’un progiciel destiné au grand public, acheté en ligne via téléchargement ou dans une boîte distribuée en commerce. Dans les projets d’une plus grande envergure – et plus encore en informatique de gestion ou dans les projets complexes – la délivrance ne peut avoir lieu qu’à l’issue d’une prestation étalée dans le temps. L’exemple typique est celui du logiciel ERP : le paramétrage, l’intégration, l’interfaçage, les éventuels développements spécifiques, la reprise des données, les tests, … représentent souvent un travail et un enjeu financier nettement supérieurs à la licence.
La délivrance est une des deux obligations essentielles imposées au vendeur par le Code civil, à côté de l’obligation de garantie.
La délivrance est d’une importance capitale car elle seule permet de considérer que la vente est pleinement exécutée : « à défaut, toutes les sanctions de l’inexécution sont envisageables, à commencer par la plus grave d’entre elle : la résolution pour inexécution »[34].
En informatique, la délivrance clôture habituellement la phase de réalisation du projet et marque le début d’une nouvelle période : la garantie si elle a été convenue, et très souvent la maintenance. Il est donc important de pouvoir dater la délivrance, et c’est tout l’enjeu des opérations dites de réception que de procéder à la datation.
Que faire quand la délivrance est tardive ? On retrouve deux grands cas de figure :
- Une date fixe est prévue au contrat.
Le contentieux sur cette question est important et étroitement lié à la façon dont la clause contractuelle est rédigée. En résumé, le juge cherche à savoir si la date contractuelle est un élément déterminant dont le non-respect lui permet de caractériser un manquement suffisamment grave pour prendre des mesures qui peuvent aller jusqu’à la résolution. Il faut en réalité en revenir au principe de convention loi, et interpréter l’exigence telle qu’elle est stipulée au contrat. L’article 1610 du Code civil confirme le principe lorsqu’il énonce les mesures qui peuvent être prises en cas de défaillance : « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
Tout est affaire de cas d’espèce. En pratique, le juge qui est confronté à un délai de rigueur dépassé même légèrement, se montrera plus sévère que celui appelé à trancher une question dans laquelle un délai indicatif a été dépassé de quelques semaines/mois dans un projet de longue haleine.
- Aucune date n’est prévue, ou la date est purement indicative.
Dans ce cas, c’est autour de la notion de « délai raisonnable » que le procès se cristallise habituellement. Le juge dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation. On prend habituellement en compte tous les faits et le contexte : nature de la chose, urgence du besoin à combler, préjudice subi suite au retard, délai d’exécution normal sur le marché, etc.
Lorsque le créancier de l’obligation constate un retard, il est nécessaire d’adresser une mise en demeure dont le but est, non seulement de constater l’inexécution du contrat à ses yeux, mais aussi de faire débuter le long processus de mise en cause du débiteur de ce chef.
En réponse, le débiteur va très souvent soutenir que le retard ne lui est pas exclusivement imputable. Le cas est très fréquent dans les projets informatiques dans lesquels la collaboration des parties est nécessaire. La question du délai se transforme alors en bouteille à encre qui peut faire perdre un temps considérable aux parties et à l’expert lorsqu’il est désigné.
3.1.1.4 L’obligation (de résultat ?) de délivrer
S’agissant d’une des obligations principales du prestataire, la délivrance conforme est habituellement considérée comme une obligation de résultat. Il y a exception pour les contrats aléatoires, ou lorsque telle est la volonté des parties pour autant que celles-ci disposent de la liberté de contractualiser cet aspect des choses.
La même chose se produit en matière de contrats informatique : l’obligation de délivrance est traditionnellement qualifiée d’obligation de résultat[35] car le client n’a accepté aucun aléa dans l’exécution de l’obligation. Dans une affaire en matière de perte de données, il a ainsi été précisé que le fournisseur est « un professionnel, […] censé connaître les caractéristiques du logiciel à installer, maîtriser les opérations techniques de l’installation et procéder en temps utile à la sauvegarde des données pour pouvoir reconstituer l’ancienne configuration en cas d’échec de l’installation. Même à supposer que l’installation faite dans des conditions normales était soumise à un quelconque aléa, celui-ci devait être prévu et maîtrisé »[36].
Pourtant, la plupart des contrats – surtout dans les projets qui impliquent des prestations intellectuelles de développement, de paramétrage ou de mise en place de processus – précisent que le fournisseur n’est tenu qu’à une obligation de moyen.
Comment articuler l’obligation de résultat de délivrer, avec l’obligation contractuelle de moyen qui pèse sur le fournisseur dans la réalisation de ses prestations ?
La réponse est dans la distinction entre la délivrance de « quelque chose » et la qualité de ce « quelque chose ». Le fait de ne pas délivrer un objet conforme peut, très fréquemment, suffire à constater l’inexécution d’une obligation de résultat et enclencher un processus pouvant amener à la résolution du contrat. Lorsque rien n’a été livré, le débat est vite clôturé, mais ce cas de figure n’est pas fréquent. La plupart du temps, quelque chose a été livré mais le client se plaint d’une discordance entre ce qu’il attendait et ce qu’il a reçu. C’est là qu’intervient l’obligation de moyen. Lorsqu’il vérifiera la discordance alléguée, le juge injectera dans l’équation le fait que le prestataire ne supporte, parce que telle est la volonté des parties inscrites dans le contrat, qu’une obligation de moyen.
Jugé dans ce sens en matière informatique que « si la prestation promise est sous la pleine et entière maîtrise du débiteur, celui-ci sera en principe tenu au résultat. Cette qualification n’implique pas nécessairement que la prestation soit dépourvue de tout aléa. Il suffit qu’elle présente une probabilité suffisamment importante de réussite, pour que le créancier puisse légitimement s’attendre à l’obtention du résultat. Dans le cas présent, on peut effectivement considérer que l’aléa était suffisamment restreint pour que l’on ait affaire à une obligation de résultat »[37].
3.1.1.5 Lien entre la délivrance et la phase précontractuelle
Il n’existe plus de frontière étanche entre l’obligation de délivrance et la phase précontractuelle (et singulièrement l’obligation d’information et de conseil). La précision est importante chaque fois qu’il apparaît, au moment de la délivrance, que le projet était voué à l’échec. A l’instar du film « Chronique d’une mort annoncée », il n’est pas rare qu’au terme du projet, ayant connaissance de l’ensemble des éléments, on réalise qu’étant donné les circonstances, il était impossible que les choses se passent bien. Bien sûr, il est toujours simple de réécrire l’histoire une fois qu’elle s’est déroulée ; néanmoins, l’hypothèse n’est pas rare. C’est par exemple le cas lorsque l’éditeur vend un logiciel qu’il a l’intention de développer comme s’il existait déjà, ou présente sa roadmap comme un fait acquis, et s’engage sur un objectif de temps intenable.
Les armes juridiques des parties au stade précontractuel ont été analysées ci-dessus ; il y est renvoyé.
Au-delà de celle-ci, la jurisprudence a créé un pont entre la phase précontractuelle et l’obligation de délivrance.
Jugé dans ce sens que l’obligation de délivrance conforme « ne doit pas s’entendre comme une simple obligation de délivrance technique (par rapport aux quantités, caractéristiques, performances, spécifications… expressément prévues). En effet, en sus de l’obligation de conformité technique, la jurisprudence consacre une obligation de conformité fonctionnelle : il faut que le client obtienne la satisfaction attendue en ce sens que le système doit atteindre les objectifs fixés par ce dernier et idéalement définis dans le contrat, compte tenu de sa nature et de sa destination »[38]. Or, c’est le plus souvent au moment de la phase précontractuelle que les objectifs sont fixés, même si c’est en termes vagues.
En France, la Cour de cassation française a rappelé au visa de l’article 1615 du Code civil, que « le manquement par le vendeur à ses obligations d’information et de conseil peut, pourvu seulement que ce manquement soit d’une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente ». En l’espèce, la Cour d’appel avait refusé de retenir le dol et décrété qu’en conséquence, il n’était pas possible de prononcer la résolution de la vente mais uniquement l’allocation de dommages et intérêts[39]. La Cour de cassation ne l’a pas du tout entendu de cette oreille. On sait combien la jurisprudence de la Cour sur le dol est sévère ; on a presque l’impression qu’elle essaye de tempérer cette sévérité avec une approche plus souple de la résolution, pourvu seulement que le manquement à l’obligation d’information et de conseil soit d’une gravité suffisante.
On peut également citer un arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 16 octobre 2015, où celle-ci juge que, « si les demandes de nullité pour dol en l’absence de démonstration de manœuvres frauduleuses et pour erreur sur la chose doivent être rejetées, le manque d’information de la société Apicus envers son client et l’absence d’étude quant aux besoins de la société le Saint Alexis quant au système de paiement sécurisé alors que le contrat portait sur l’amélioration du site internet et que le mode de paiement s’agissant d’un site marchand est un élément à définir précisément ont conduit à la fourniture d’un site internet inadapté aux besoins évidents du client et donc à une inexécution de son obligation de délivrance conforme. Il sera en conséquence fait droit à la demande de résolution du contrat et la société Apicus sera déboutée de sa demande en paiement de sa prestation soit la somme de 14.465,78€ augmentée des intérêts »[40].
3.1.2 La réception
3.1.2.1 Régime général
La délivrance et la réception sont les côtés pile et face de la même pièce. On enseigne que « l’obligation de réception qui pèse sur le client est la contrepartie de l’obligation de délivrance qui pèse sur le prestataire informatique. Cette obligation de réception existe dans tous les contrats informatiques, qu’ils aient pour objet la vente ou le louage d’un matériel, d’un système informatique, la fourniture d’un logiciel ou d’une prestation informatique »[41].
Au-delà des aspects matériels, la réception « consiste pour le client en la vérification et l’approbation du travail ou de la chose livrée, au sens des articles 1790 et 1791 du Code civil. Mais elle est aujourd’hui étendue et pratiquée dans tous les contrats de mise à disposition, y compris le contrat de vente »[42].
Tel est l’enjeu véritable de la réception : reconnaître la bonne exécution par le prestataire de son obligation de délivrance conforme.
Cela amène souvent à distinguer le procès-verbal de réception du procès-verbal de conformité.
En 2006, la Cour de cassation française a invité à faire cette distinction. Madame X signe un bon de livraison le 4 novembre 1999 et un rapport d’installation le 6 novembre 1999. Sur ces bases, le banquier qui finance le matériel paie le vendeur. Mécontente du matériel, Mme X obtient plus tard la résolution du contrat de fourniture aux torts du vendeur. La cour d’appel refuse par contre la résolution du contrat de crédit-bail aux motifs que Mme X n’établit pas la faute qu’elle allègue à l’encontre du banquier qui a payé sur présentation des bons de livraison et d’installation précités.
Pour la Cour de cassation, « en se déterminant ainsi, alors que le contrat prévoyait que le locataire « atteste de la conformité de la livraison et du bon état de marche du matériel par la signature d’un procès-verbal de réception qu’il transmet immédiatement au bailleur, pour lui permettre de payer le fournisseur », la cour d’appel, qui n’a pas relevé l’existence d’un tel procès-verbal, ni caractérisé les raisons pour lesquelles le crédit-bailleur aurait légitimement pu passer outre à son absence, n’a pas donné de base légale à sa décision »[43].
3.1.2.2 La recette
Puisque l’enjeu de la réception est la vérification de la délivrance conforme, il arrive fréquemment que de nombreuses vérifications doivent être faites. C’est ce que l’on appelle la procédure de réception (en Belgique) ou la procédure de recette (en France).
La clause contractuelle réglementant cette procédure est, au stade de la négociation du contrat, un enjeu majeur. En effet, c’est le principe de la convention loi qui régit cette procédure. Lorsque le contrat prévoit une procédure et attache des conséquences juridiques à celle-ci et aux constatations qui en découlent, les juges ont souvent à cœur de se tenir au contrat.
Dans les projets d’une certaine complexité, la recette est souvent divisée en deux étapes :
- La recette provisoire. Il s’agit d’une vérification prima facie. Elle se fait très fréquemment sur la base d’un jeu de tests. En France, elle correspond à la VABF des marchés publics (Vérification d’Aptitude au Bon Fonctionnement). Les blocages se focalisent la plupart du temps sur la gravité des anomalies. Le client, soucieux de protéger ses intérêts, aura tendance à refuser la recette, même provisoire, dès que les anomalies présentent une certaine gravité. Le fournisseur, soucieux d’accélérer la recette, aura à l’inverse tendance à demander la recette provisoire quitte à l’assortir de réserves (ce qui signifie que les opérations de recette se poursuivent et que le fournisseur dispose, jusqu’à la recette définitive, d’un laps de temps pour corriger ce qui doit l’être).
- La recette définitive. Il s’agit d’une vérification en profondeur. Elle se fait la plupart du temps sur la base d’une utilisation en service régulier, aussi appelée utilisation en production : comment le logiciel se comporte-t-il lorsqu’il est soumis à un usage normal correspondant à l’activité habituelle pour laquelle il a été acquis. En France, elle correspond à la VSR des marchés publics (Vérification de Service Régulier). Les blocages se focalisent surtout sur la durée de cette période de vérification, et sur les conséquences des anomalies constatées. Le client aura toujours tendance à allonger la durée de vérification et à refuser d’accorder la recette définitive tant qu’il existe des anomalies, même non-bloquantes. Le fournisseur aura à cœur de raccourcir la durée de vérification et insistera pour obtenir une recette définitive, quitte à l’assortir de réserves. À nouveau, la façon dont le contrat a été rédigé apparaît cruciale dans ce débat. La pratique contractuelle fait souvent la distinction entre les anomalies bloquantes, majeures et mineures : la recette définitive est souvent jugée incompatible avec la moindre anomalie bloquante mais elle doit tolérer un nombre limité d’anomalies majeures, et un nombre un peu plus élevé d’anomalies mineures.
La tension qui peut entourer les opérations de recette est à la hauteur des conséquences de celle-ci.
Le tribunal de commerce de Marseille l’a encore rappelé : « l’usage veut que lorsque l’on prononce une recette et notamment une recette définitive, les réserves sont des points mineurs à finaliser (peu importe leur nombre), ne remettant pas en cause la bonne finalité du projet. A défaut la recette ne doit pas être prononcée »[44]. En l’espèce, après un long chemin de croix, le client avait accepté de signer un procès-verbal de recette définitive. Il voulait, nonobstant la recette, contraindre le fournisseur à livrer des fonctionnalités qui manquaient. Le tribunal l’a débouté.
Si l’on examine la jurisprudence de façon globale, on observe un mouvement cohérent : les juges ne se limitent pas aux clauses mal rédigées ou aux apparences (par exemple la présence d’un procès-verbal de livraison) lorsqu’ils vérifient si la recette – au sens de vérification de la délivrance conforme – a été prononcée. Il n’hésitent pas à remettre en cause l’existence même de la recette s’ils constatent, à l’aune des pièces du dossier, que la vérification n’a pas pu avoir lieu. Par contre, lorsque les parties ont pu vérifier le respect de la délivrance conforme, ils attachent à la recette toutes les conséquences juridiques qui en découlent, quitte à se montrer sévères avec le client qui aurait été léger (ou trop gentil) à l’occasion des opérations de vérification.
3.1.3 Garanties
En matière de vente, le Code civil impose une double obligation de garantie au vendeur, au bénéfice de l’acheteur : une garantie d’éviction et une garantie des vices cachés. On se limite ici à la garantie légale des vices cachés, prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil (français ou belge – quoique des différences existent entre les deux textes et l’interprétation qui en est donnée).
Diverses conditions sont requises : le chose doit être affectée d’un vice, qui doit être grave, caché, inconnu de l’acheteur et antérieur à la vent. En matière de logiciel, il a été admis que pouvait constituer un vice, la lenteur d’exécution du programme, la présence d’un virus voire encore la perte ou la détérioration des données à l’occasion de l’utilisation du programme[45].
La jurisprudence estime qu’il y a vice, non seulement en cas de défaut structurel de la chose (vice intrinsèque), mais également lorsqu’elle ne répond pas à l’usage particulier auquel l’acheteur la destine, et qui est connu du vendeur, conformément aux dispositions contractuelles (conception fonctionnelle du vice). En pratique, la notion de vice fonctionnel fait l’objet de controverses, notamment lorsqu’il s’agit d’articuler la garantie des vices cachés avec l’obligation de délivrance conforme.
S’il apporte la preuve de ces différents éléments, l’acheteur dispose d’un droit d’option : conformément à l’article 1644 du Code civil, il peut intenter l’action rédhibitoire – restitution de la chose et remboursement du prix et des frais de la vente – ou l’action estimatoire – conservation de la chose mais remboursement d’une partie du prix. Si le vendeur est de mauvaise foi et connaissait les vices de la chose, l’acheteur peut réclamer, outre le remboursement du prix et les frais de la vente, des dommages et intérêts complémentaires (art. 1645 C. civ.).
3.2 Les recours en cas d’inexécution des obligations contractuelles
En cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse, par le prestataire, de ses obligations contractuelles, le droit des contrats met à la disposition du client plusieurs recours. On peut aussi imaginer que ce soit le client qui manque à ses obligations : en général, il sera en défaut de payer le prix demandé par le prestataire.
Dans la plupart des cas, ce sera d’ailleurs le point de départ du litige entre les parties. S’estimant lésé, le client refusera de payer la somme demandée par le prestataire. Celui-ci introduira ensuite une action devant la juridiction compétente, pour obtenir du juge qu’il condamne son cocontractant au paiement. Pour se défendre, ce dernier fera une demande reconventionnelle pour postuler l’exécution en nature du contrat, la réduction du prix et/ou sa dissolution, ainsi que le paiement de dommages-intérêts à titre d’indemnisation du préjudice subi.
Les règles en la matière se trouvent dans le Code civil.
En droit français, il faut se référer aux nouveaux articles 1217 et suivants du Code civil, qui ont le mérite de réunir dans une même section les sanctions susceptibles d’être prononcées, tout en clarifiant le régime à divers égard.
Ainsi, le nouvel article 1217 du Code civil établit que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
-refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
-poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
-solliciter une réduction du prix ;
-provoquer la résolution du contrat ;
-demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Auparavant, ces sanctions étaient dispersées dans le Code civil ou constituaient des principes généraux du droit consacrés en jurisprudence. Aussi fallait-il nécessairement avoir égard à la jurisprudence pour connaître précisément leurs conditions de mise en œuvre et leurs conséquences. En droit belge, cette situation est toujours de mise, en attendant une révision du Code civil sur ce point.
Après avoir rappelé l’exigence de la mise en demeure préalable ainsi que l’incidence de la force majeure ou de clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, on examine chacune de ces sanctions – exception d’inexécution, exécution en nature, réfaction, responsabilité contractuelle et résolution.
Il appartient au créancier de choisir avec soin la mesure qu’il entend mettre en œuvre, à l’aune de l’objectif poursuivi (poursuivre la relation contractuelle ou, au contraire, y mettre fin). Une distinction importante doit aussi être faite entre les sanctions qui requièrent l’intervention du juge et celles qui peuvent être actionnées par le créancier seul, dans le cadre d’un système de justice privée.
3.2.1 La mise en demeure
On considère généralement que la mise en demeure est le préalable nécessaire aux sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles.
En France, elle est expressément requise pour l’exécution forcée en nature (art. 1221 du Code civil), la réduction du prix (art. 1223 du Code civil) ou la résolution du contrat (art. 1225 du Code civil).
Son objectif est d’interpeller le débiteur, de manière ferme et non équivoque, en le sommant d’exécuter les obligations qui lui incombent.
A défaut de disposition spécifique dans le contrat (qui pourrait exiger un envoi recommandé, par exemple), on estime généralement que les exigences formelles sont assez souples.
A des fins probatoires, il est cependant recommandé de se ménager une preuve de cette mise en demeure (et du moment auquel elle a été transmise). Aussi est-il préférable de transmettre la mise en demeure par écrit, en recourant à un service d’envoi recommandé.
3.2.2 Incidence de la force majeure ou des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité
3.2.2.1 Force majeure
L’application des mesures visant à sanctionner l’inexécution des obligations contractuelles pourrait se voir paralysée s’il apparaît que les manquements trouvent leur origine dans un événement de force majeure.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code civil français, la notion n’était pas définie légalement.
La jurisprudence considérait généralement qu’étaient visés les événements imprévisibles et irrésistibles, indépendants de la volonté du débiteur ou extérieurs à celui-ci. On note que cette dernière condition faisait l’objet de discussions en droit français. Pour le reste, les conditions sont appréciées de manière raisonnable, de sorte que la force majeure ne vise pas nécessairement un événement totalement insurmontable.
Par ailleurs, il n’est pas rare de trouver une définition de la force majeure, accompagnée d’une liste non-exhaustive d’exemples, dans les contrats IT, avec l’indication des conséquences d’un tel événement sur l’exécution du contrat. S’agissant de conventions généralement rédigées par le prestataire, la notion est, dans la plupart des cas, définie largement. Quant aux exemples, ils ne constituent pas nécessairement des cas de force majeure suivant la définition retenue par la jurisprudence. Ce faisant, l’entreprise IT parvient, indirectement mais de façon certaine, à limiter sa responsabilité.
Désormais, on trouve une définition de la force majeure dans le Code civil français, au nouvel article 1218 du Code civil. D’après celui-ci, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Les effets d’un tel événement de force majeure sont par ailleurs réglés par le second alinéa de cette disposition, qui distingue suivant que l’événement de force majeure est temporaire ou pas. Dans le premier cas, « l’exécution du contrat est suspendue, à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat ». En cas d’empêchement définitif, par contre, « le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
3.2.2.2 Clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité
Les contrats IT contiennent généralement des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité.
En droit commun des contrats, leur validité est parfaitement admise, pour autant que certaines conditions soient respectées (ne pas vider le contrat de sa substance, ou ne pas porter atteinte à l’ordre public ou à une disposition impérative, par exemple). Dans les contrats conclus avec des consommateurs, il faut aussi avoir égard au régime des clauses abusives.
Le cas échéant, ces clauses doivent être prises en considération au moment de mettre en œuvre les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles (voy. toutefois infra, concernant la résolution du contrat).
3.2.3 L’exception d’inexécution
Dans un contrat synallagmatique, l’une des parties peut suspendre l’exécution de ses obligations, sans intervention préalable du juge, aussi longtemps que son cocontractant n’a pas honoré les siennes. Ce faisant, elle soulève l’exceptio non adimpleti contractus[46]. Il s’agit d’un principe général de droit.
En droit français, ce principe est désormais visé aux articles 1219 et 1220 du Code civil. Plus précisément, l’article 1219 du Code civil consacre la jurisprudence en la matière, en permettant à une partie de « refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». Il est également permis au créancier, conformément à l’article 1220, de suspendre l’exécution de son obligation, avant même que l’exécution du contrat ait commencé, « dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle ». Une notification dans les meilleurs délais est, dans ce cas, requise.
Dans un litige soumis à la Cour d’appel d’Amiens, celle-ci a refusé d’appliquer l’exception d’inexécution invoquée par le client pour s’opposer au règlement des factures[47]. Elle constate en effet qu’il se borne à se plaindre « d’un nombre quasi incommensurable de problèmes rencontrés avec le matériel (…) d’une multitude de problèmes rencontrés et non résolus (…) d’un problème de virus à la mi-août 2001, de l’impossible inscription du symbole de l’euro, du logiciel de facturation ne reconnaissant que le franc ». Elle ajoute qu’ « outre la circonstance que ces griefs n’ont été formulés qu’après qu’il ait reçu deux lettres en date des 18 et 21 avril 2001 de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE lui rappelant qu’elle était toujours dans l’attente de ses règlements, il y a lieu de constater qu’ils ne sont pas établis ».
Dans une affaire tranchée par la jurisprudence belge, le client paie les factures qui lui sont adressées, à concurrence de 23.282,73 EUR, mais refuse de s’acquitter d’une facture de 1.550 EUR, représentant les 50% d’un progiciel commandé par avenant ultérieur. De manière générale, il estime en effet que les logiciels fournis et installés par le prestataire ne donnent pas satisfaction. Sans mise en demeure préalable, ce dernier bloque unilatéralement l’accès aux autres logiciels, pourtant dûment payés par le client. La Cour d’appel de Bruxelles juge qu’il ne lui était pas permis, dans cette hypothèse, d’invoquer l’exception d’inexécution : elle décide en effet qu’ « il n’y a pas de proportion raisonnable entre l’obligation que le cocontractant n’aurait pas exécutée [la paiement de 50% d’une licence d’un logiciel] et l’obligation dont le contractant qui constate la faute contractuelle suspend l’exécution [l’accès à d’autres logiciels] »[48].
Il faut en effet se rappeler que l’exception d’inexécution doit être invoquée de bonne foi et dans le respect du principe de proportionnalité.
3.2.4 L’exécution en nature
Le créancier de l’obligation non respectée peut d’abord et avant tout faire le choix de contraindre son contractant à exécuter le contrat. Ledit créancier veillera à faire précéder son action d’une mise en demeure, sauf exceptions (par exemple si la mise en demeure est, en fonction des spécificités de la cause, inutile).
3.2.4.1 Action en paiement contre le client
L’exécution forcée est fréquente lorsque c’est le client qui est en défaut, par exemple s’il ne paie pas la facture sans motif valable. Le fournisseur a rarement intérêt à solliciter la résolution de la vente. Ayant exécuté sa partie du contrat, il entend plus simplement contraindre le client à respecter ses obligations.
L’action en paiement est simple… sauf lorsque le client contre-attaque en remettant en cause le respect par le fournisseur de ses propres obligations.
Les choses peuvent toutefois se compliquer lorsque parallèlement à l’action en paiement, le fournisseur entend faire cesser l’utilisation du système informatique, du logiciel ou plus généralement de l’objet du contrat. La situation est fréquente dans les contrats SaaS et cloud : le fournisseur dispose d’un moyen de pression considérable sur son client puisqu’il peut facilement lui bloquer l’accès à la plate-forme. Cela arrive aussi avec des systèmes informatiques plus classiques lorsqu’ils sont équipés de dongles ou autre système logiciel (par exemple des clés d’activation avec une durée limitée). Il s’agit ni plus ni moins d’une forme d’exception d’inexécution ; nous renvoyons à l’étude séparée qui y est consacrée.
3.2.4.2 Exécution en nature du prestataire
L’exécution en nature revient à contraindre le cocontractant à exécuter sa part du contrat.
Il est parfaitement possible d’imaginer que l’obligation de délivrance fasse l’objet d’une demande d’exécution forcée en nature : le client demande au juge de contraindre le fournisseur à livrer. Il peut également demander d’assortir la condamnation d’une astreinte.
On rappelle qu’une astreinte est une condamnation à vocation dissuasive. Le juge prévoit – souvent sur une base journalière – une somme d’argent qui est due tant que la décision judiciaire n’a pas été exécutée. Il n’est donc pas question de confondre l’astreinte avec la réparation du préjudice : ce qui a été payé au titre de l’astreinte ne peut pas être défalqué du montant du préjudice.
Le choix de l’action – exécution en nature ou par équivalent sous la forme de l’octroi d’une somme d’argent – appartient au créancier de l’obligation, c’est-à-dire généralement le client lorsque c’est un défaut de délivrance qui est en cause. Un tel choix ne peut toutefois donner lieu à un abus de droit de la part du créancier. En ce sens, on note d’ailleurs qu’aux termes du nouvel article 1221 du Code civil français, « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ».
Il n’est pas possible pour le vendeur de contre-attaquer en demandant la résolution du contrat. Pourtant, la demande est fréquente : le prestataire se dit qu’il préfère rembourser et arrêter le projet plutôt qu’être condamné à exécuter des prestations qu’il sait ne pas pouvoir assurer, ou qui risquent de lui coûter plus cher que la résolution. Ceci n’est pas envisageable juridiquement. La Cour de cassation l’a rappelé à de multiples occasions : admettre ce raisonnement reviendrait à revenir sur le caractère essentiel de l’obligation de délivrance, et elle s’y refuse même si les considérations économiques militent souvent pour cette solution.
A l’inverse, le client qui a fait choix d’une exécution forcée en nature peut-il, en cours de procédure, changer d’avis et demander la résolution ? La réponse est positive : « à moins d’avoir expressément renoncé à demander la résolution, l’acheteur qui s’est engagé dans la voie de l’exécution forcée de la vente peut revenir sur son choix, tant que la décision judiciaire n’est pas devenue définitive »[49].
C’est même une situation que l’on rencontre couramment dans la pratique. L’instruction de la cause – surtout s’il y a une expertise judiciaire qui a été ordonnée – fait apparaître qu’il est plus sage d’annuler les opérations et de recommencer ab initio un nouveau projet au lieu de s’entêter dans une exécution forcée.
L’exécution en nature n’est pas le cas le plus fréquent dans les contrats informatiques. La raison est plus pratique que juridique. Il est souvent jugé contre-productif de forcer un prestataire à s’exécuter sous la menace d’une astreinte, surtout si le défaut est causé par la complexité du projet. Le prestataire ne va pas soudain devenir meilleur parce qu’il a été condamné. Par contre, il est certain que les relations vont se tendre, voire se dégrader fortement. Dans la mesure où les projets informatiques nécessitent très souvent la collaboration des parties, cette tension effraie souvent le client qui va renoncer à exiger l’exécution en nature.
Il faut toutefois se rappeler que, dans le cadre de l’exécution en nature, une faculté de remplacement est mise à la disposition du client : conformément au nouveau article 1222 du Code civil français, « après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin ». Cette disposition ajoute que « Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction ».
3.2.5 Réfaction du contrat
La réfaction est une hypothèse moins connue qui permet au créancier de l’obligation non respectée de maintenir le contrat tout en renégociant judiciairement ses termes. On y a recours dans certains cas particuliers, singulièrement lorsque la défaillance, certes réelle, apparaît somme toute minime en regard des enjeux globaux. Le créancier se dit qu’il a trop à perdre à introduire une action en exécution forcée ou en résolution et il préfère conserver le bien ; mais en même temps, il se refuse à simplement laisser tomber toute réclamation car la défaillance est bien là.
Le cas typique est celui d’un client qui constate une fonctionnalité manquante et qui décide de s’en passer moyennant une réduction du prix. S’il n’y a pas d’accord avec le fournisseur, le client introduira une action en réfaction et demandera au juge de pouvoir conserver le système tout en réduisant le coût à payer afin de refléter le préjudice que représente l’absence de ladite fonctionnalité.
Le mécanisme était déjà admis en jurisprudence et consacré par certaines dispositions légales particulières (action estimatoire dans le cadre de la garantie des vices cachés, par exemple – cf. art. 1644 du Code civil), en Belgique et en France. Il est désormais expressément consacré par le Code civil français à l’article 1223.
Aux termes de cette disposition, « le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais ».
On observe utilement que l’autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire.
On trouve parfois des contrats dans lesquels la réfaction est au contraire citée comme la seule mesure que le client peut prendre à l’égard d’un prestataire défaillant. La logique est la suivante : le prestataire sait au départ qu’il y a un risque de mauvaise exécution et il préfère cadrer les actions que son client peut prendre. Il ne veut ni la résolution qui l’oblige à restituer le prix, ni l’exécution en nature qui peut vite coûter très cher. Forcer la réfaction est en quelque sorte une mesure de défense. La clause n’est pas illicite. Toutefois, il arrive que les juges l’écartent et admettent malgré tout la résolution si l’inexécution porte sur une obligation fondamentale. Tout est affaire de cas d’espèce.
3.2.6 L’exécution par équivalent (ou la responsabilité contractuelle)
3.2.6.1 Régime général
S’il est établi que le fournisseur du système informatique a commis une faute contractuelle (inexécution, exécution tardive, partielle ou défectueuse), en lien de causalité avec un dommage, sa responsabilité contractuelle peut être engagée.
Les dispositions en la matière figuraient, jusqu’il y a peu, aux articles 1146 et suivants du Code civil. En outre, on pouvait se référer à la jurisprudence, qui avait établi les critères à prendre en considération pour apprécier si, et à quelles conditions, la responsabilité contractuelle d’un cocontractant peut être engagée.
Désormais, mais en droit français uniquement, les règles sont établies aux nouveaux articles 1231 et suivants du Code civil (à droit quasi-constant).
Ainsi, le nouvel article 1231 du Code civil énonce que « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».
L’article 1231-1 ajoute que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Quant aux dommages et intérêts, ils doivent couvrir la perte du créancier ou le grain dont il a été privé (art. 1231-2), étant entendu que le débiteur n’est tenu qu’aux dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat (sauf dol ou faute lourde)[50] et qui sont une suite directe et immédiate de l’inexécution (même en cas de dol ou de faute lourde)[51].
En France, dol et faute lourde sont assimilés. Ce n’est pas le cas en droit belge.
3.2.6.2 Charge de la preuve
Pour identifier celle des parties sur laquelle repose la charge de la preuve et, plus précisément, pour apprécier l’intensité de la preuve à apporter, il importe de déterminer si les obligations du fournisseur du système informatique sont de moyen ou de résultat.
La jurisprudence permet d’illustrer l’intérêt de la distinction, tout en précisant les critères de qualification[52]. En l’occurrence, l’obligation d’un fournisseur consistait à récupérer les données du système du client et à adapter un logiciel standard à ses besoins. Nonobstant l’expertise et l’audition de l’expert, le Tribunal souligne que de nombreuses incertitudes subsistent ; il est donc impossible d’identifier précisément les causes de l’échec. La distinction entre l’obligation de moyen et de résultat prend dès lors tout son sens : s’il apparaît qu’il s’agit d’une obligation de résultat, il appartient uniquement au client de démontrer que le résultat promis n’a pas été en l’espèce (ce qui est le cas puisque l’implémentation est un échec). Le fardeau de la preuve qui lui incombe est donc très léger puisqu’il ne doit pas démontrer que le fournisseur a commis une faute (ce qui eût été le cas s’agissant d’une obligation de moyen). Pour échapper à sa responsabilité, celui-ci doit renverser la présomption de faute en apportant la preuve d’une cause étrangère exonératoire.
En l’absence de dispositions contractuelles spécifiques, le Tribunal recherche la volonté des parties en se fondant sur le critère de l’aléa. Il décide que « si la prestation promise est sous la pleine et entière maîtrise du débiteur, celui-ci sera en principe tenu au résultat. Cette qualification n’implique pas nécessairement que la prestation soit dépourvue de tout aléa. Il suffit qu’elle présente une probabilité suffisamment importante de réussite, pour que le créancier puisse légitimement s’attendre à l’obtention du résultat. Dans le cas présent, on peut effectivement considérer que l’aléa était suffisamment restreint pour que l’on ait affaire à une obligation de résultat ». En conséquence, la charge – et le risque – de la preuve repose sur le débiteur (le fournisseur du système informatique). Il lui incombe dès lors de supporter l’incertitude quant à l’origine de l’échec.
La faute contractuelle doit être en lien de causalité avec le dommage. Il est jugé qu’une société de fourniture informatique a commis une faute contractuelle dans la mesure où, suite à l’installation d’un scanner, et en l’absence d’un écran de contrôle, elle n’a pas placé de switch permettant au client d’être averti du mauvais fonctionnement du système de backup et n’a pas attiré l’attention de ce dernier sur la nouvelle procédure à suivre en la matière. Le dommage réside dans la perte de trois mois d’encodage. Appliquant la théorie de l’équivalence des conditions, la Cour d’appel de Liège se demande si ce dommage se serait produit tel qu’il s’est produit in concreto si ledit switch avait été placé et si l’information requise avait été communiquée au client. Selon la Cour, « il saute aux yeux qu’il n’est pas possible de répondre à cette question avec certitude car ces deux conditions étant remplies, il reste à savoir ce que D. aurait effectivement fait : aurait-elle pris les mesures nécessaires pour que son personnel suive l’opération de backup qu’elle réalisait de nuit, celui-ci aurait-il été attentif aux messages du serveur, aurait-il fait le nécessaire voulu en conséquence ? » En conséquence, elle décide que le lien de causalité n’est pas certain.
Autrement dit, en l’absence de certitude, il est seulement probable que, sans la faute, le dommage se serait produit tel qu’il s’est produit in concreto. Pour engager la responsabilité contractuelle du fournisseur et permettre l’indemnisation du client, on pourrait se fonder sur la théorie de la perte d’une chance, en remplaçant le préjudice réellement subi par la perte d’une chance que ce préjudice ne se réalise pas. Suite à la faute du fournisseur de système informatique, le client a en effet perdu une chance de prendre conscience des problèmes de backup et d’empêcher la perte de trois mois d’encodage de données. La Cour d’appel de Liège fait expressément référence à un arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2004 (rendu en chambres réunies). Si la doctrine est loin d’être unanime quant à la portée à donner à celui-ci, la majorité des commentateurs semblent considérer que la Cour a condamné cette conception (dite extensive) de la perte d’une chance[53]. Aussi la Cour d’appel de Liège décide-t-elle que la demande du client ne peut être accueillie et confirme le jugement entrepris. Dans un arrêt du 5 juin 2008, qui doit être approuvé, la première chambre (néerlandophone) de la Cour de cassation a toutefois affirmé clairement que la perte d’une chance d’éviter un préjudice peut être indemnisée[54]. A la lumière de cet arrêt, saisi de faits similaires, les juges du fond auraient dès lors pu considérer que les conditions de la responsabilité contractuelle étaient réunies et réparer le dommage résidant dans la perte d’une chance d’éviter le risque survenu.
Appliquant la théorie de la perte d’une chance, on peut également citer une décision rendue par le Tribunal de commerce de Paris le 13 septembre 2011[55]. Suite à la rupture du contrat qui liait la plateforme Pixmania à l’un de ses vendeurs, Dimitech, la première a (notamment) été condamnée à verser à ce dernier une somme d’un million d’euros, en vue de réparer la perte d’une chance d’obtenir une levée de fond de 5 millions d’euros.
L’auteur de la faute peut bénéficier d’une exonération (totale ou partielle) de sa responsabilité s’il apparaît que la victime a également commis une faute, en lien de causalité avec le dommage. Tel peut être le cas lorsqu’elle n’a pas procédé à la sauvegarde des données enregistrées dans son système informatique et que celles-ci sont perdues. Le client a ainsi été tenu de supporter la moitié[56] ou le tiers[57] des conséquences résultant de l’absence de backup.
3.2.7 La résolution du contrat
3.2.7.1 Régime général
La résolution est en quelque sorte l’opposé de l’exécution forcée en nature : celle-ci a pour but de faire produire à la convention tous les effets que les parties avaient à l’esprit au moment de sa conclusion, tandis que la résolution a pour but dissoudre le contrat et de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si la convention n’avait pas été conclue.
Nous avons vu que la partie qui opte pour l’exécution forcée peut, tant que la décision n’a pas été rendue, modifier sa demande et solliciter la résolution. L’inverse est vrai également. Le débiteur de l’obligation à lui aussi son mot à dire, contrairement à ce qui se passe dans le cadre de l’exécution en nature : recevant une demande de résolution, il peut proposer d’exécuter.
Avant l’entrée en vigueur de la réforme du Code civil français, la résolution était uniquement visée à l’article 1184 du Code civil. La jurisprudence avait toutefois précisé les conditions dans lesquelles le créancier peut demander la fin du contrat, soit au titre de la justice privée – résolution unilatérale –, soit en s’adressant aux juridictions compétentes – résolution judiciaire, ainsi que les effets attachés à ces sanctions. En droit belge, il faut continuer à s’y référer, exclusivement.
En droit français, par contre, on peut désormais avoir égard aux nouveaux articles 1224 et suivants du Code civil qui consacrent, de manière générale, les solutions prétoriennes qui avaient été admises auparavant. D’après l’article 1224 du Code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Des dispositions contractuelles spécifiques sont ainsi introduites pour chacune de ces trois hypothèses.
L’article 1225 du Code civil définit la clause résolutoire comme celle qui « précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat ». Il ajoute qu’elle est « subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Le nouvel article 1226 détermine quant à lui les conditions à respecter par le créancier pour procéder à la résolution unilatérale du contrat : mise en demeure préalable, mentionnant qu’à défaut, pour le débiteur, de s’exécuter, il pourra mettre fin au contrat en procédant à sa résolution ; en cas d’inexécution persistante, notification de la résolution au débiteur, avec l’indication des raisons qui la motivent. Il est expressément précisé que cette sanction est mise en œuvre aux risques et périls du créancier, qui s’expose, le cas échéant, à une contestation de celle-ci en justice, par le débiteur (c’est du reste expressément précisé à l’article 1226, alinéa 3, du Code civil). Il incombera alors au créancier de démontrer la gravité de l’inexécution.
Enfin, comme l’indique l’article 1227 du Code civil, « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ». L’article 1228 du Code civil confirme ensuite que l’intervention du juge peut consister à constater la résolution (en cas de clause résolutoire ou de résolution unilatérale) ou à prononcer celle-ci, s’il est saisi en ce sens par le créancier, et qu’une inexécution suffisamment grave est constatée. Cette disposition mentionne aussi les autres options à la disposition du magistrat : « ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » (sur ces autres recours, voy. supra).
3.2.7.2 L’inexécution
La résolution constitue une sanction propre conçue dans le but de permettre au créancier d’une obligation de se délier du contrat inexécuté, en procédant à son anéantissement.
En ce sens et après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de cassation, un auteur considère que « le mécanisme de la résolution est trop éloigné de celui de la responsabilité contractuelle pour qu’on puisse voir dans la première une application de la seconde. L’anéantissement du contrat est autre chose que la responsabilité civile. […] La résolution est un mécanisme original irréductible à un autre »[58].
La résolution ne requiert ni la démonstration d’une faute, ni la preuve d’un dommage : « il est généralement admis que l’inexécution est une condition nécessaire et suffisante de la résolution. (…) Il n’est pas non plus nécessaire que l’inexécution ait causé un préjudice au créancier (…) »[59]. Dans le même sens, la jurisprudence admet parfaitement que la résolution puisse être prononcée « en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, alors même que cet empêchement résulterait de la force majeure »[60] (sur le rôle de la force majeure, voy infra).
Approuvant la jurisprudence, la doctrine affirme d’ailleurs que « la résolution du contrat doit pouvoir être prononcée dès lors qu’il y a inexécution, même si celle-ci n’est pas fautive »[61].
Un autre auteur explique que « la résolution judiciaire n’implique plus le caractère fautif de l’inexécution. Cette position se justifie sans doute par la considération de l’utilité économique du contrat : la résolution est possible dès que celle-ci a cessé, même sans faute »[62].
A contrario, lorsque la résolution suppose l’existence d’une faute ou d’un dommage, la loi l’exige expressément : « Certaines dispositions légales exigent cependant que la faute soit caractérisée, afin de protéger le débiteur : c’est le cas de la rupture des baux ruraux (C. rur. art. L. 411-31) ou de celle du contrat de travail par licenciement (C. trav., art. L. 1232-1) »[63].
Il ne s’agit donc pas d’établir une faute et d’en rechercher l’auteur ; il s’agit d’établir l’inexécution d’une obligation – en l’occurrence ce sera la plupart du temps la délivrance conforme. D’où vient alors la confusion fréquente qui voit tant de plaideurs se déchirer sur la faute ? Elle résulte probablement pour une part d’une mauvaise compréhension du mécanisme de la résolution ; elle est surtout la conséquence du débat sur l’indemnisation du préjudice qui résulte de la résolution. Ce débat prend tant de place qu’il en absorbe parfois la discussion sur la défaillance.
On connaît de surcroît la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’obligation de résultat emporte présomption de faute. La résolution étant la sanction d’une violation de l’obligation de délivrance conforme, elle-même qualifiée d’obligation de résultat (voy. supra), on aura vite fait de superposer les notions de défaillance et de faute. Ce n’est pourtant pas la manière correcte de procéder. Au stade de la question de principe relative à la résolution, le critère est la défaillance suffisamment grave ; la notion de défaillance fautive s’invite au débat ultérieurement au niveau de l’analyse des conséquences de la résolution, notamment en ce qui concerne l’octroi de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice intégral (voy. supra).
3.2.7.3 La gravité de l’inexécution
L’incompréhension dénoncée ci-dessus provient en partie du fait que le débiteur de l’obligation qui fait face à une action en résolution, va se défendre en invoquant deux types d’arguments :
- D’une part, il va relever le rôle joué par le client lorsque le projet informatique requiert sa collaboration, arguant qu’il n’est pas le seul responsable.
- D’autre part, il va relativiser le manquement et tenter de démontrer que la défaillance n’est pas grave.
Le débiteur a raison d’agir de la sorte. La jurisprudence constante exige en effet que la défaillance soit suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire. Toutefois, ce débat sur la gravité ne doit pas occulter le fait que l’action en résolution n’est pas une mise en cause d’une responsabilité, mais bien une méthode singulière de résoudre un contrat qui n’a pas produit les effets que les parties entendaient y attacher au moment où ils ont conclu.
Savoir si la défaillance est suffisamment grave procède d’une analyse factuelle qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Jugé dans ce sens :
- Par la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 mars 2009, que la résolution est indiquée pour un contrat de prestation de services informatiques (création de site Web) dans lequel le prestataire n’a pas été en mesure de fournir à son client le site Web avec les fonctionnalités attendues[64].
- Par la Cour d’appel de Bordeaux, dans un récent arrêt du 29 janvier 2015, que la résolution d’une convention d’intégration est adéquate car, « alors que la société (prestataire) s’est engagée par contrat (…) à fournir des prestations clairement définies dans des délais et moyennant une rémunération déterminées, au terme d’engagements qui, de l’accord des parties, constituaient une obligation de résultat à la charge de l’opérateur, le résultat n’a pas été atteint par la faute présumée (du prestataire) qui ne peut s’en exonérer que par la preuve de la cause étrangère exonératoire (…) »[65].
- Par la Cour d’appel de Grenoble, le 4 juin 2015, que la résolution d’un contrat informatique est justifiée, aux torts exclusifs des prestataires. Il a été reproché au premier d’avoir gravement manqué à son obligation de conseil en ne vérifiant pas que le développeur « disposait de l’expérience et des compétences requises dans le domaine spécifique des logiciels de gestion de biens immobiliers » pour lequel il avait été sollicité. Il a été reproché au second de n’avoir pas respecté les délais promis en raison de l’absence de formalisation par lui d’un cahier des charges précis. Ces manquements ont été jugés suffisamment graves pour justifier la résolution des conventions.
- Par le Tribunal de commerce de Paris, que le prestataire a « failli à son engagement contractuel de résultat en n’ayant procédé à aucune livraison contractuellement acceptable de fournitures et prestations après le dépassement de 10 à 12 mois du délai contractuellement engageant »[66]. Le Tribunal a ensuite condamné le prestataire à des dommages et intérêts significatifs en prenant en considération tout à la fois le temps passé par le personnel du client pour établir les spécifications du logiciel et pour le suivi du projet, les dépenses matérielles effectuées en pure perte, le temps perdu en interne pour travailler en mode dégradé et plus généralement la désorganisation des équipes du client.
- Par la Cour d’appel de Paris, qui a approuvé cette décision, estimant que le prestataire « avait souscrit une obligation de résultat » et qu’il « n’a pas été en mesure de fournir la prestation promise, qu’il n’a pas correctement apprécié les besoins de sa cliente et partant, l’ampleur de la tâche que cette opération imposerait »[67].
On rappelle que la jurisprudence a créé un pont entre la phase précontractuelle et la sanction – via la résolution – d’une violation de l’obligation de délivrance (voy. supra). La Cour de cassation a en effet admis que « le manquement par le vendeur à ses obligations d’information et de conseil peut, pourvu seulement que ce manquement soit d’une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente »[68].
3.2.7.4 Lien avec la recette
Les développements qui précèdent, consacrés à la procédure de recette, en lien étroit avec la problématique de la résolution. En effet, la recette ayant pour enjeu de vérifier le respect par le fournisseur de son obligation de délivrance conforme, il est difficile pour le client de prétendre l’existence d’une défaillance grave s’il a accordé cette recette.
Les actions en résolution se transforment donc fréquemment en débat sur l’existence alléguée d’une recette. La stratégie consiste dans ce cas à déplacer le débat : la question n’est plus de savoir si l’obligation de délivrance conforme a été respectée ou non, mais bien de savoir si le client a accepté la situation qu’il dénonce.
Tel est bien le message rappelé par la décision marseillaise commentée ci-dessus : « l’usage veut que lorsque l’on prononce une recette et notamment une recette définitive, les réserves sont des points mineurs à finaliser (peu importe leur nombre), ne remettant pas en cause la bonne finalité du projet. A défaut la recette ne doit pas être prononcée »[69].
Lorsqu’il n’y a pas de documents stipulant expressément l’existence ou non d’une recette, éventuellement assortie de réserves, il faudra vérifier dans les faits et pièces du dossier la volonté des parties. La recette peut en effet être tacite, sauf disposition contractuelle contraire. Elle doit par contre être certaine. Le juge prendra notamment en compte le temps qui s’est écoulé, la correspondance, le contexte … pour en déduire l’existence ou non d’une recette tacite.
La matière informatique pose un problème particulier lié à la nécessité d’essayer le système avant de pouvoir se forger une opinion claire, complète et motivée. Souvent, le contrat a été rédigé par le prestataire et stipule que la mise en production équivaut à la recette. Comment résoudre cette question ?
De toute évidence, la mise en production est un élément qui plaide en faveur de l’existence d’une recette. C’est encore plus vrai lorsque le contrat assimile la mise en production à la recette. La situation est meilleure encore pour le prestataire lorsque la mise en production n’est assortie d’aucune réserve.
De là à en déduire la fin de l’histoire, il y a un pas.
On l’a vu, la jurisprudence s’éloigne des apparences pour se poser une autre question : le client a-t-il eu la possibilité de vérifier la conformité de ce qui a été délivré ? Les juges refusent les clauses qui empêchent la vérification de la conformité puisque la délivrance conforme est une obligation fondamentale ; a fortiori refusent-ils les situations de fait qui rendent cette vérification impossible.
On va donc s’intéresser à la nature du système et se demander s’il était possible de se prononcer sur la recette sans l’utiliser. Après avoir rappelé l’importance de procéder sans tarder aux vérifications, la doctrine enseigne en effet que « toutefois, s’agissant d’appareils techniques la comparaison n’est possible que pendant la période de mise au point et d’essai (CA Paris 3 déc. 1976 : JCP G 1977, Il, 18579, 2e esp. – 4 et 24 janv. 1980 : RJ com. 1980, p. 260, note Ph. le Tourneau). Ainsi, l’acheteur d’une machine à libeller des chèques dits « infalsifiables » ne peut invoquer la contravention à la délivrance qu’après une période d’essai de cette machine au cours de laquelle il est victime de chèques falsifiés (Cass. com., 17 juin 1997 : Bull. civ. IV, n° 195 ; JCP E 1997, II, 1022, note F. Labarthe ; Resp. civ. et assur. 1997, comm. p. 368. – Rappr. Cass. 1re civ., 17 juin 1997 (2 arrêts) : Bull. civ. I, n° 205 et 206 ; Contrats, conc., consom. 1997, comm. n° 163, note L. Leveneur ; D. affaires 1997, p. 1218 ; JCP E 1998, 611, n° 16, obs. D. Mainguy) »[70]. Ces considérations sont parfaitement en ligne avec la pratique de la recette en deux temps – provisoire et définitive, la dernière nécessitant une ville fixation de service régulier en environnement réel. Il n’est pas exagéré d’écrire que plus le système est complexe, plus il est nécessaire de laisser au client la possibilité de le tester – et si nécessaire l’utiliser en conditions réelles – avant de se prononcer sur la recette.
3.2.7.5 Effets de la résolution
3.2.7.5.1 Effets ex tunc ou ex nunc ?
Le principe fondamental de la résolution était le suivant : le juge va remettre les parties, autant que faire se peut, dans la situation qui serait la leur si la convention n’avait jamais existé.
Il en découle que la résolution produits des effets ex tunc (terme latin signifiant ‘depuis l’origine‘ par opposition aux effets ex nunc qui ne valent que pour l’avenir). S’il y a moyen, le juge fera remonter les effets de la résolution jusqu’à la seconde qui a précédé la conclusion de la convention.
Parfois, ce n’est pas possible. Par exemple, s’agissant d’un contrat de maintenance, on voit mal comment il serait possible de remonter le temps et supprimer les services de maintenance dont le client a bénéficié. Il en va de même lorsqu’un logiciel comptable a été utilisé : il n’est pas possible de revenir sur les encodages, les déclarations TVA, et toutes les opérations comptables effectuées. Dans ce cas, le juge déterminera le moment jusqu’où il est possible de faire remonter les effets de la résolution. Dans le pire des cas, celle-ci ne produira ses effets que pour l’avenir (ex nunc) ; cela a tendance à devenir de facto une habitude dans les contrats à prestations successives.
C’est du reste la solution qui est désormais consacrée dans les nouvelles dispositions du Code civil français : l’article 1229, alinéa 2, du Code civil, énonce en effet que « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ». L’alinéa 3 ajoute ensuite que « lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
3.2.7.5.2 Restitutions réciproques
La conséquence première de la résolution est la restitution réciproque : la chose livrée est restituée au vendeur, lequel doit rendre le prix payé. Dans les litiges informatiques, la chose livrée est souvent immatérielle (prestation intellectuelle, développements spécifiques, logiciel, licence, etc.). Cela ne pose généralement pas de problème : la restitution se fait sous la forme de l’arrêt de l’utilisation et/ou la restitution des supports éventuels.
La restitution réciproque est une conséquence automatique de la résolution. L’un ne va pas sans l’autre.
Désormais, en droit français, le régime des restitutions fait l’objet de dispositions spécifiques. Traitant des effets de la résolution, l’article 1229, alinéa 4, du Code civil, renvoie ainsi aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil. Le principe posé à l’article 1352 nouveau est le suivant : « la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
Lorsque l’enjeu du contrat porte sur du matériel hardware, on se pose souvent la question de sa dépréciation entre le moment de la conclusion du contrat et la restitution. On a parfois l’impression d’une double peine qui frappe le vendeur : non seulement il doit rendre le prix perçu, mais en outre il récupère une machine obsolète dont le client s’est entre-temps servi. Peut-il réclamer une indemnité pour l’utilisation du matériel et/ou sa dépréciation ? La réponse n’est pas aisée, mais on dira que c’est plus souvent négatif. Si la dépréciation résulte uniquement de l’utilisation, il est rare que les juges octroient une dépréciation. C’est ce que l’on peut retenir d’un arrêt de 2007 de la Cour de cassation : « attendu qu’en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, le vendeur n’est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose ; qu’ayant relevé que le bien vendu n’avait fait l’objet d’aucune dégradation, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé »[71]. Par contre, si la dépréciation résulte d’un mauvais entretien ou d’une mauvaise utilisation, l’indemnisation redevient possible car la cause de la dépréciation n’est plus l’effet rétroactif de la résolution mais un comportement inadéquat du client. C’est du reste le principe qui est consacré au nouvel article 1352-1 du Code civil, aux termes duquel « celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute ».
Dans les autres cas (logiciel, maintenance, etc.), il s’agira davantage d’une prestation de service et, dans ce cas, l’article 1352-8 nouveau du Code civil français prévoit que « la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ».
3.2.7.5.3 Réparation du préjudice intégral
Au-delà de la restitution, celui qui obtient la résolution du contrat doit voir son préjudice réparé intégralement.
On entre ici dans un débat classique de responsabilité : pour obtenir satisfaction, le plaignant doit établir la sainte-trilogie : faute, dommage, et lien de causalité.
Le débat sur la faute nécessite un rappel : la résolution exige la preuve d’une défaillance, mais pas nécessairement d’une faute (voy. supra). Le bénéficiaire de la résolution qui souhaite obtenir la réparation de son préjudice de la restitution, doit démontrer à ce niveau que la défaillance est fautive.
Le dommage réparable est celui prévu par le droit commun de la responsabilité : tout le dommage, mais rien que le dommage. Les nouveaux articles 1231 et suivants du Code civil français constituent le siège de la matière (à ce sujet, voy. supra). Les dommages fréquemment invoqués incluent les coûts internes des équipes, les pertes d’exploitation et/ou de rentabilité, l’atteinte à l’image, etc.
3.2.7.5.4 Clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité
Imaginons le cas d’école suivant : le juge prononce la résolution d’un contrat d’informatisation d’une entreprise, ordonne la restitution du prix payé et octroie 1 million d’euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d’exploitation car le logiciel devait permettre des réductions importantes de charges dont l’entreprise n’a pas pu bénéficier. Le contrat dont le juge prononce la résolution stipule – clause fréquente entre professionnels – que la responsabilité du prestataire ne pourra jamais excéder une somme de 100.000 € toutes causes confondues.
Deux écoles s’affrontent. Pour la première, puisque le contrat est résolu ex nunc et réputé n’avoir jamais existé, la clause limitative est réputée n’avoir jamais été conclue. Pour la seconde, malgré la résolution, il y a des clauses qui continuent à produire des effets malgré la résolution, soit en raison de leur nature, soit parce que telle est la volonté expresse des parties. Dans notre exemple, la différence est de 900.000 € tout de même …
Comment arbitrer ce conflit ?
La faute lourde ou le dol prive d’efficacité les clauses limitatives. C’est une des raisons pour lesquelles le plaideur bien avisé doit soigneusement arbitrer ces moyens juridiques. Obtenir la résolution pour réticence de dolosive au stade précontractuel est parfois plus intéressant que solliciter la même mesure pour défaut de livraison. Gagner sur le dol est certes plus difficile, mais permet d’éviter tout risque par rapport à la clause de responsabilité.
Lorsque l’acheteur est un consommateur, il sera possible de plaider la clause abusive ; rien n’exclut de tenter la même chose lorsque le client est un professionnel profane.
Pour le reste, les choses ne sont pas claires.
Certes, la Cour de cassation a jugé que « la résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les clauses limitatives de responsabilité »[72]. Nul ne sait s’il s’agit d’un arrêt de principe. Il a été rendu en matière de vente ; aurait-on un attendu aussi tranché si le contrat avait porté sur une prestation de services ?
On suggère parfois de faire la part des choses entre le défaut total de délivrance conforme, et le défaut partiel. On peut comprendre la logique, mais elle repose sur une approche jurisprudentielle instable. La frontière entre le défaut partiel ou total n’est pas claire. Plus fondamentalement, y a-t-il juridiquement une raison de traiter différemment les deux hypothèses lorsqu’on se pose la question de principe de la validité de la clause limitative post-résolution ? La jurisprudence est divisée, et très casuistique.
[1] J.O.R.F., n° 0035 du 11 février 2016.
[2] Cass. Comm., 26 novembre 2003, n° 00-10.243, RTD Civ., 2004, p. 80, obs. J. Mestre et B. Fages.
[3] Cass. Civ., 7 janvier 2009, n° 07-20.783, JurisData : 2009-046461.
[4] En Belgique, voy. l’art. 1108 du Code civil, qui mentionne aussi la cause. En France, voy. le nouvel article 1128 du Code civil.
[5] En Belgique, voy. l’article 1134, al. 3, du Code civil. En France, voy. le nouvel article 1104 du Code civil.
[6] On ne s’en étonne guère, eu égard à l’objet de la prestation, par nature très technique, et au déséquilibre généralement constaté entre les parties, en particulier sur le plan des connaissances.
[7] Soulignant l’obligation d’information du fournisseur au moment de la commande, voy. Liège, 19 février 2002, Entr. Dr., 2003, p. 133.
[8] Bruxelles, 11 décembre 2007, inédit, 2007/AR/2207 : « c’est à la SA I., spécialiste en la matière, qu’il incombait de s’informer précisément des exigences et espérances du client, du matériel dont il disposait et du hardware et du software dont il aurait besoin pour atteindre le résultat souhaité ».
[9] CA Paris, pôle 5 – chambre 11, 16 octobre 2015, disponible sur www.legalis.net.
[10] S’agissant d’une relation contractuelle nouée entre un professionnel, spécialiste en la matière et un client, dont les connaissances sont généralement moindres, l’obligation d’information du fournisseur est appréciée plus sévèrement. Il lui incombe en effet de rééquilibrer la relation contractuelle et luttant contre l’asymétrie informationnelle dont est victime son cocontractant.
[11] Bruxelles, 2 mai 2007, DAOR, 2008/85, p. 65.
[12] Comm. Courtrai, 23 juin 2003, T.G.R., 2004, p. 286, note.
[13] Cass. Com., 11 juillet 2006, n° 04-17.093, JurisData : 2006-034736.
[14] CA Paris, pôle 5 – chambre 11, 11 mai 2011, disponible sur www.legalis.net.
[15] En Belgique, voy. l’art. 1382 du Code civil. En France, voy le nouvel art. 1240 du Code civil.
[16] En France, voy. les nouveaux articles 1132 et s. du Code civil
[17] En Belgique, voy. les articles 1109-1110 du Code civil (sur les conditions de l’erreur vice du consentement, voy., de manière générale, S. Stijns, D. Van Gerven et P. Wéry, « Chronique de jurisprudence – Les obligations : les sources (1985-1995) », J.T., 1996, pp. 709-710, nos 52 et s. ; M. Coipel, Eléments de théorie générale des contrats, Bruxelles, E. Story-Scientia, 1999, pp. 50-53, n° 66 ; C. Goux, « L’erreur, le dol et la lésion qualifiée : analyse et comparaison », R.G.D.C., 2000, pp. 13 et s., nos 7 et s.).
[18] Sur ce point, voy. le nouvel article 1133 du Code civil français, qui énonce que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».
[19] Cass., 24 septembre 2007, J.L.M.B., 2008, p. 1171.
[20] CA Versailles, 14e chambre, 28 octobre 2009, disponible sur www.legalis.net.
[21] Cass. Com., 4 juin 2013, disponible sur www.legalis.net.
[22] CA Bordeaux, 1ère ch. Civile, section B, 29 janvier 2015, disponible sur www.legalis.net.
[23] Sur le régime de la nullité, voy., en droit français, les nouveaux articles 1178 et suivants du Code civil.
[24] Ainsi, l’article 1114 du Code civil français indique que “l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ». Quant à l’acceptation, elle est visée à l’article 1118 du Code civil, aux termes duquel « l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre ».
[25] Comm. Liège, 14 décembre 2007, Inédit, R.G. A/05/2415.
[26] Il est également jugé que « le principe de l’exécution de bonne foi des conventions et l’usage en matière commerciale exigent, compte tenu de la rapidité nécessaire des transactions commerciales, entre commerçants qui se connaissent et sont en relations d’affaires, que le co-contractant réagisse en faisant immédiatement connaître son refus ou sa désapprobation, par écrit ou éventuellement verbalement avec confirmation écrite, à la réception d’une facture, d’un relevé de compte ou d’une lettre ».
[27] CA Paris, 5e ch., section A, 2 juillet 2003, cité par Lamy droit du numérique, éd. 2016, n° 754, p. 539.
[28] Ph. Le Tourneau, Contrats informatiques et électroniques, 7e édition, Paris, Dalloz, 2012, n° 3.65, p. 138.
[29] J. Gatsi, « Fascicule 290 – Vente commerciale, Obligation de délivrance du vendeur – Mise à disposition de la chose », JurisClasseur Contrats – Distribution, n° 7.
[30] CA Versailles, 3e ch., 26 octobre 1990, D., 1991, somm. p. 166, obs. O. Tournafond ; Cass. 1re civ., 3 mai 2006, n° 04-20.432, Bull. civ. 2006, I, n° 217.
[31] Cass. com., 5 octobre 2010, n° 08-11.630, JurisData n° 2010-017800.
[32] Cass. Comm., 19 février 2008, n° 06-17.669, cité dans Lamy droit du numérique, Ed. 2015, n° 951.
[33] Cass. Com., 11 juillet 2006, n° 04-17.093, JurisData : 2006-034736.
[34] J. Gatsi, « Fascicule 290 – Vente commerciale, Obligation de délivrance du vendeur – Mise à disposition de la chose », JurisClasseur Contrats – Distribution, n°6.
[35] En matière de fournitures informatiques, voy. D. Gobert et E. Montero, « Les obligations de conformité et de garantie des vices cachés en matière informatique : le contrat au secours des incertitudes légales et jurisprudentielles », Ubiquité, 2002, p. 12 ; Ch. Steyaert, « Droit des obligations – Contrats », Droit de l’informatique et des technologies de l’information. Chronique de jurisprudence (1995-2001), Dossier du J.T. n° 41, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 25, n° 13.
[36] C.S.J. Luxembourg, 5 février 2003, DAOR, 2003/67, p. 47, note H. Jacquemin.
[37] Comm. Mons, 21 octobre 2008, inédit, A/03/216, cité par H. Jacquemin, « Contrats informatiques », Chronique de jurisprudence en droit des technologies de l’information (2002-2008), R.D.T.I., 2009, pp. 38-39.
[38] D. Gobert et E. Montero, « Les obligations de conformité et de garantie des vices cachés en matière informatique : le contrat au secours des incertitudes légales et jurisprudentielles », Ubiquité, 2002, pp. 11-12.
[39] Cass. com., 3 février 2009, n° 08-15.307, JurisData : 2009-046871.
[40] CA Paris, pôle 5 – chambre 11, 16 octobre 2015, disponible sur www.legalis.net.
[41] Lamy Droit du numérique, Ed. 2015, n° 797.
[42] Lamy Droit du numérique, Ed. 2016, n° 781.
[43] Cass Comm., 20 juin 2006, n° 05-14.432, Jurisdata : 2006-034368.
[44] Tribunal de commerce de Marseille, 15 octobre 2013, disponible sur www.legalis.net.
[45] Sur l’application de la garantie des vices cachés en matière informatique, voy. D. Gobert et E. Montero, op. cit., pp. 14 et s. Voy. aussi la jurisprudence citée dans les différentes chroniques : J.-P. Buyle, L. Lanoye, et A. Willems, « Chronique de jurisprudence : L’informatique (1976-1986), J.T., 1988, p. 99, n° 21 ; J.-P. Buyle, L. Lanoye, Y. Poullet et V. Willems, « Chronique de jurisprudence : L’informatique (1987-1994), J.T., 1996, p. 209, n° 18 ; C. Steyaert, « Droit des obligations – Contrats », Droit de l’informatique et des technologies de l’information. Chronique de jurisprudence (1995-2001), Dossier du J.T. n° 41, Bruxelles, Larcier, 2003, pp. 29 et s. En France, même si la jurisprudence semble avoir admis le recours à la garantie des vices cachés, l’analyse est contestée par certains auteurs (A. Lucas, J. Deveze et J. Frayssinet, op. cit., pp. 504-505, n° 759). Voy. aussi Lamy Droit du numérique, 2016, nos 775 et s.
[46] Sur cette mesure et, en particulier, l’exigence d’un manquement grave ou d’une condition de proportionnalité, voy. B. Dubuisson et J.-M. Trigaux, « L’exception d’inexécution. Rapport belge », M. Fontaine et G. Viney (sous la dir. de), Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles. Etudes de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, L.G.D.J., Paris, 2001, pp. 85 et s., nos 36 et s.
[47] CA Amiens, 31 mai 2007, JurisData : 2007-336426.
[48] Bruxelles, 11 décembre 2007, inédit, 2007/AR/2207.
[49] JurisClasseur Contrat-Distribution, fascicule 310, n° 26.
[50] Art. 1231-3 du Code civil français.
[51] Art. 1231-4 du Code civil français.
[52] Comm. Mons, 21 octobre 2008, inédit, A/03/216.
[53] Cass. (ch. réun.), 1er avril 2004, Arr. Cass. 2004, liv. 4, p. 549, J. dr. jeun., 2004 (somm.), liv. 239, p. 44, J.T., 2005, p. 357, note N. Estienne, « L’arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2004 : une chance perdue pour les victimes de fautes médicales ? », J.L.M.B., 2006, p. 1076, note A. Pütz et E. Montero, « La perte d’une chance d’éviter la réalisation d’un risque : un préjudice illusoire », N.j.W., 2005, p. 628, note S. Lierman, Pas., 2004, p. 527, R.W., 2004-05, p. 106, note I. Boone, « Het ‘verlies van een kans’ bij onzeker causaal verband », R.G.D.C., 2005, p. 368, note C. Eyben, « La théorie de la perte d’une chance défigurée ou revisitée ? », Bull. ass., 2006, p. 235. Sur cet arrêt et l’interprétation qui peut en être donnée, voy., outre les commentaires précités, R. Marchetti, E. Montero et A. Pütz, « La naissance handicapée par suite d’une erreur de diagnostic : un préjudice réparable ? La perte d’une chance de ne pas naître ? », note sous Civ. Bruxelles, 21 avril 2004, R.G.D.C., 2006, pp. 127-132, nos 17-21 ; B. Dubuisson, « La théorie de la perte d’une chance en question : le droit contre l’aléa », J.T., 2007, pp. 490-491.
[54] Cass., 5 juin 2008, J.T., 2009, p. 29, note A. Pütz, Bull. ass., 2008, p. 418, note H. Bocken, NjW, 2009, p. 31, R.W., 2008-09, p. 795, note S. Lierman, Rev. dr. santé, 2008-09, p. 210, note S. Lierman. Sur cet arrêt, voy. aussi H. Bocken, « Verlies van een kans. Het cassatie arrest van 5 juni 2008. Vervolg en (voorlopig?) slot », NjW, 2009, pp. 2-12.
[55] Comm. Paris, 13 septembre 2011, disponible sur www.legalis.net.
[56] Liège, 19 février 2002, Entr. Dr., 2003, p. 133.
[57] Gand, 14 avril 2008, inédit, 2006/AR/3087 (disponible sur www.juridat.be).
[58] Ch. Larroumet, Droit civil. T. III, Les Obligations. Le contrat. Effets, 6e éd., Paris, Economica, 2007, p. 817, n° 710.
[59] JurisClasseur Contrats – Distribution, Fasc. 175 « Exitinction du contrat » – Les causes, n° 159.
[60] Cass. 3e civ., 6 mai 2009, n°08-13.824 : JurisData n° 2009-048136.
[61] M. Fabre-Magnan, Droit des obligations. 1. Contrat et engagement unilatéral, 3e éd., Paris, PUF, 2012, p. 655. En ce sens, Ph. Malaurie, L. Aynes et Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, Paris, Defrénois, 2003, p. 424, n° 877.
[62] Ph. Le Tourneau, op. cit., n° 3.93.
[63] Idem.
[64] Paris, 25e ch., sect. A, 4 mars 2009, SARL Veille Recherche Développement et Conseil sur l’internet (VRDCI) c. SARL Non d’un Net !, Juris-Data, n° 2009-375695, cité par H. Bitan, op. cit., p. 60.
[65] Bordeaux, 1re ch. civ., sect. B., 29 janvier 2015, IBM France et BNP Paribas Factor / Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (www.legalis.net).
[66] T. com. Paris, 2 juin 2009, Exposium c/Axe Sélection, Expertises 2010, no 346, p. 107 et 117, note Chatain A.
[67] CA Paris, Pôle 5, ch. 101, 19 janv. 2011, Expertises 2011, no 360, p. 270.
[68] Cass. com., 3 févr. 2009, n° 08-15.307 : JurisData n° 2009-046871.
[69] Tribunal de commerce de Marseille, 15 octobre 2013, disponible sur www.legalis.net.
[70] Juris-classeur, op. cit., fascicule 310, n° 96.
[71] Cass. Comm., 30 octobre 2007, n° 05-17.882, JurisData : 2007-041137.
[72] Cass. Comm., 5 octobre 2010, JCP G 2011, p. 63, obs. P. Grosser.